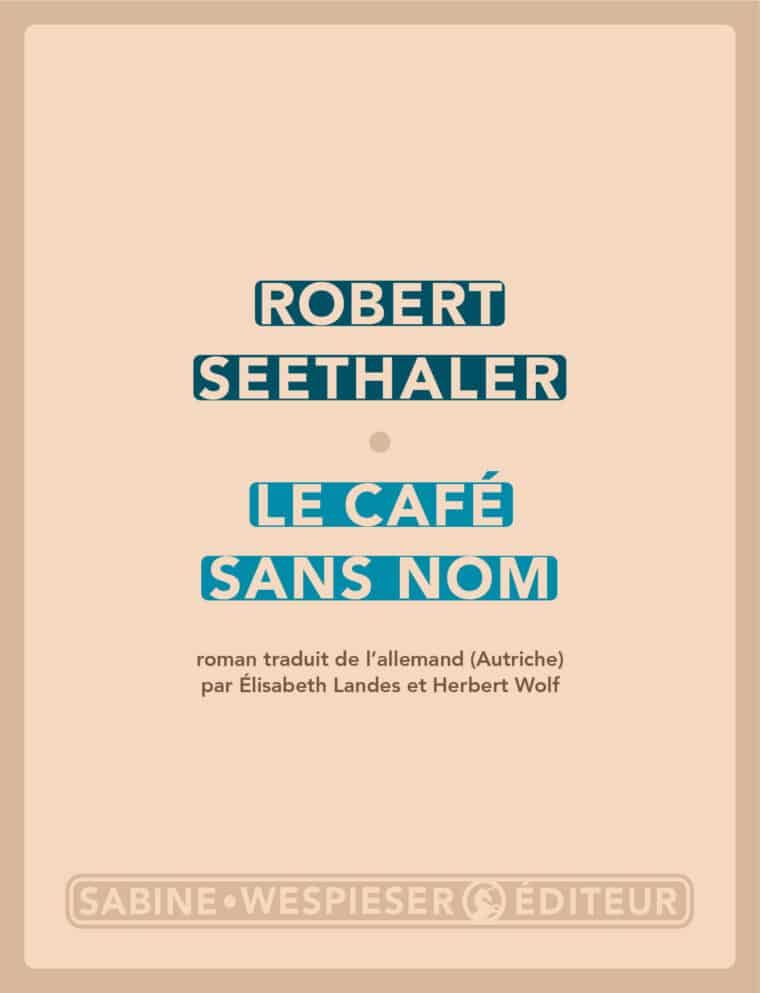
- Livre : Le Café sans nom
- Auteur : Robert SEETHALER
- Article complet
- Revue de presse
EN ATTENDANT NADEAU, Jean-Luc Tiesset, mardi 10 octobre 2023
À Vienne, on ne fait pas que valser
L’Autrichien Robert Seethaler, qui a participé comme acteur ou scénariste à de nombreuses créations pour le théâtre, le cinéma ou la télévision, est de ces auteurs venus à la littérature par le détour du spectacle. Ses premiers essais dans le domaine de l’écriture se prêtaient d’ailleurs si bien à une adaptation dramatique que plusieurs de ses récits connurent à l’écran une seconde vie – dont la réputation a malheureusement fort peu souvent franchi la frontière française : dans le film Der Trafikant de Nikolaus Leytner, par exemple, tiré du roman homonyme intitulé en français Le tabac Tresniek, le grand Bruno Ganz en personne tint le rôle de Sigmund Freud (c’est ce même livre, traduit en 2014, qui fit connaître Robert Seethaler dans notre pays). En attendant Nadeau a recensé Le champ et Le dernier mouvement.
S’il arrive de croiser parmi les personnages fictifs de Robert Seethaler des gloires internationales comme Sigmund Freud ou Gustav Mahler, le roman Le café sans nom se passe au sein de la population d’un faubourg viennois telle qu’elle existait encore vingt ans après la Seconde Guerre mondiale, avant la mise en place de la politique de modernisation menée par Bruno Kreisky, ministre des Affaires étrangères puis chancelier fédéral d’Autriche : dès le début du roman, l’affirmation selon laquelle « du bourbier du passé allait émerger un avenir radieux » n’est toutefois qu’un cliché qui sonne faux, un credo trop forcé, trop ironique pour susciter l’entière adhésion. L’année même de la naissance de Robert Seethaler,1966, ouvre la décennie couverte par le roman. C’est celle où les grandes réformes politiques et sociales se répercutent sur le paysage, tandis que les habitants sortent difficilement d’une période historique douloureuse, et que les comptes sont loin d’être réglés avec le passé national-socialiste dans lequel l’Autriche avait pris une part active. Comme le remarque sans aménité un des personnages du roman, « un Viennois sur deux est nazi. Où est-ce qu’ils seraient tous passés sinon ? » Quant aux plus anciens, ils se souvenaient encore de l’Empire, disparu dans les fumées de la Première Guerre mondiale.
Le champ avait pour cadre le cimetière d’une petite ville imaginaire où les morts, délestés d’une vie qui n’avait guère laissé de traces ni de souvenirs, s’adressaient à qui pouvait les entendre et esquissaient les contours d’une époque passée en se racontant eux-mêmes. On retrouve les mêmes petites gens attablés au Café sans nom, mais ils sont cette fois bien vivants, et ils habitent la capitale autrichienne. Le modeste établissement qui les accueille, qui constitue l’espace clos de ce roman, est précisément dépourvu d’enseigne pour n’attirer et ne décourager personne, ouvert à tout et à tous comme « un endroit auquel se raccrocher » quand le monde se met à tourner trop vite. Il est tenu par Robert Simon, un trentenaire qui ne possède guère que son courage et sa bonne volonté. Le Café sans nom n’a cependant rien de commun avec ces endroits élégants où l’élite littéraire et artistique côtoyait jadis l’aristocratie civile et militaire ; elles font toujours partie intégrante de la culture viennoise et incarnent le passé glorieux de la capitale impériale. Simple bistrot situé près d’un marché populaire dans un quartier ouvrier à la périphérie de la ville, c’est le lieu de tous les ragots et le point de ralliement de ceux qui viennent y boire un verre pour oublier leurs misères et commenter les événements du jour. Ils entrent en scène tour à tour, comme dans un mini-théâtre du monde où la mort compterait les heures, comme les personnages d’une pièce où se joue la complainte d’une humanité oubliée, exclue de l’histoire telle qu’on aime la raconter. Déclassés, ratés, alcooliques parfois, bourrés de défauts mais jamais indignes, à l’image de cet ivrogne : « Il est vieux et sale et peut-être qu’il ment. Mais il a sa fierté. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. »
Chacun tient donc son rôle dans ce roman composé de trente-neuf saynètes, gravitant autour du bistrotier et maître d’œuvre Robert Simon. Parmi « tous ces êtres paumés qui se retrouvaient chaque jour dans son café », on trouve des piliers du récit comme son ami et confident le boucher Johannes Berg, et des personnages récurrents comme les deux commères qui propagent les nouvelles en commentant les événements à leur façon. Ils sont entourés d’une nébuleuse de laissés-pour-compte, comme la jeune chômeuse Mila qui aide Simon pour le service, le catcheur René Wurm qui participe à des combats truqués sur le Heumarkt, la toxico Jascha… Tous sont attachants, chacun a sa personnalité et son histoire, souvent accablante, mais leur révolte se limite le plus souvent à un mot, une critique formulée du bout des lèvres, qui peut exceptionnellement se faire plus explicite : « les temps présents n’étaient qu’une tumeur qui proliférait sur le terreau d’un passé pourri, dévoyé, et finirait forcément par attaquer l’avenir et mener à la perte irrémédiable de tout ce qui rendait la vie encore un peu supportable » : c’est justement ce que tous ces gens simples viennent chercher dans ce café, survivance déjà menacée des temps anciens. De l’amitié, un peu de chaleur humaine – mais pour l’amour, c’est autre chose, c’est compliqué et ce n’est guère à leur portée. Leur velléité de contestation à peine exprimée le cède d’ailleurs à la résignation, fût-elle de façade, car tous sont sans illusions face à la vie qu’ils ne peuvent cependant d’un même mouvement s’empêcher d’aimer de toutes leurs forces.
À la différence d’un Thomas Bernhard, par exemple, Robert Seethaler suggère plus qu’il ne dit – de toute façon, « les gens qui ont des choses à dire, généralement ils ne parlent pas ». Il s’efforce donc de faire tenir à ses personnages un langage juste et vrai, mais en leur mettant en bouche des propos sobres et parfois truculents. Il suffit d’écouter la veuve Pohl, logeuse et confidente de Simon, évoquer son mari mort à la guerre : « Globalement, c’était un brave homme, dit-elle. Quand je pense que je n’arrive même plus à me souvenir de son visage. » Par son écriture retenue, le travail de l’auteur rappelle souvent celui d’un peintre miniaturiste, ou d’un aquarelliste : tout est dit en peu de mots, parfois en demi-teinte, d’un trait rapide et léger où ni le remords ni la retouche ne sont de mise, où l’image prend forme par touches successives. Ainsi par exemple : « Le boucher avait un journal à la main, mais ne lisait pas, il regardait par l’embrasure de la porte la rue qui baignait dans la lumière jaune de l’après-midi. Il faisait chaud, une petite brise soufflait et le parfum suave des fleurs du lierre se mêlait aux effluves de viande, de poisson et de légumes. »
La phrase peut se condenser au point de résumer une vie humaine en quelques formules lapidaires, comme le fait une des deux commères, volontiers mauvaise langue : « Ensuite il a épousé sa secrétaire. De vingt ans plus jeune. Divorce. Arrêt du cœur. Cimetière central. Des choses qui arrivent. » Mais si l’auteur contient ainsi son écriture, cela ne l’empêche en rien d’explorer finement la gamme des sentiments humains, en agrémentant volontiers son récit d’une note d’humour : « On est à Vienne où quelqu’un de gentil c’est tout de suite suspect ». Une variété dans le style que la traduction d’Élisabeth Landes et Herbert Wolf rend parfaitement.
La capitale autrichienne en pleine mutation, mais qui a gardé la trace de ses différents passés, fournit à l’auteur qui la connaît bien un cadre idéal. Le café sans nom lui réserve une place si importante qu’elle se mêle dès le début à la texture d’un roman conçu pour elle. Les rues et les places y figurent nommément, le lecteur est près d’en voir les couleurs, d’en sentir les odeurs : la présence de la ville double celle des personnages. Le moindre détail est vrai, jusqu’à l’effondrement du Reichsbrücke le 1er août 1976, que Seethaler fait ainsi entrer dans la littérature. Tout comme l’autobus rouge qui tomba dans le Danube lors de cet accident, effectivement réparé et réutilisé jusqu’en 1989 avant de rejoindre le Musée des transports de Vienne. L’art de Robert Seethaler consiste donc à donner à l’événement une valeur allégorique, à rendre concret le moment où la ville moderne fit craquer la géographie ancienne, symbole d’un nouvel ordre qui inspirait autant la crainte qu’il permettait d’espérer. Car si l’ancien n’offrait rien qu’on pût regretter, l’actuel était encore trop incertain.
Observant leur entourage immédiat, les personnages de Robert Seethaler en perçoivent aussi l’instabilité et entrevoient une réalité plus fuyante, plus onirique. Simon, en particulier, « sentait quelquefois le réel lui échapper […] perdait le sentiment du temps et du lieu ». Étonné d’être là, lui qui regarde tant les autres est tout à coup frappé par leur étrangeté : est-il nécessaire d’avoir étudié pour se découvrir philosophe ou psychologue, faire l’expérience que nul jamais ne connaît personne, et qu’on a bien du mal à se connaître soi-même ? « Peut-être était-ce pour soi qu’on restait la plus grosse énigme. » Le roman rend alors un discret hommage à tous ceux qui ont jadis, dans la grande tradition austro-hongroise, exploré l’inconscient et joué avec l’irrationnel. N’a-t-on pas surnommé la Vienne de Sigmund Freud « la ville des rêves » ? Mais comment oublier que « lorsqu’il se réalise, le rêve disparaît » ?
Cette finesse que Robert Seethaler prête à ses personnages issus du peuple s’exprime dans la poésie naturelle et parfois maladroite de leurs paroles et de leurs gestes. Perplexes devant le changement, inquiets de ne pas y trouver leur place, ils frôlent parfois le désespoir, mais l’envie qu’ils ont de se laisser surprendre jusqu’au bout par le spectacle du monde et de ceux qui l’habitent finit par l’emporter. Ils n’ont après tout rien à regretter : « je me réjouis de demain, juste parce que ce ne sera plus aujourd’hui », et ne vaut-il pas mieux « friser l’imbécillité que l’amertume » ?