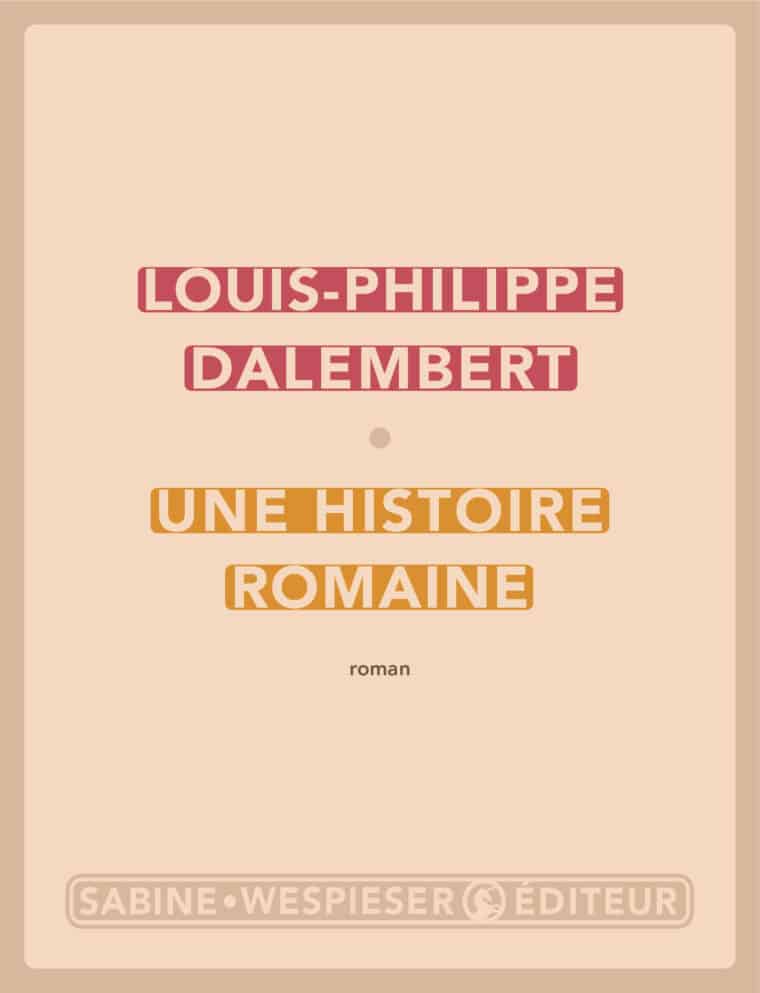
- Livre : Une histoire romaine
- Auteur : Louis-Philippe DALEMBERT
- Revue de presse
EN ATTENDANT NADEAU, Marc Lebiez, mercredi 13 septembre 2023
Les amateurs de littérature italienne auront la joie de découvrir cet automne un nouveau romancier italien, l’écrivain français Louis-Philippe Dalembert. Cet ancien pensionnaire de la Villa Médicis a acquis une fine connaissance de Rome et des Romains, qui fonde son amour de la Ville éternelle et de ceux qui y vivent – ne serait-ce que comme personnages de son roman. Il parle d’eux sur le ton détaché et souriant que l’on peut adopter à propos de familiers que l’on aime bien.
Chacune des trois parties de ce roman est centrée sur une des femmes d’une même famille. Trois générations sont ainsi représentées, la plus jeune étant sensiblement celle de l’auteur. L’ensemble pourrait constituer une saga familiale s’il y avait volonté de globalisation ou d’exemplarité. Au lieu de quoi on est devant trois portraits distincts de personnages qui ne se ressemblent guère et dont on nous raconte assez peu d’actions, plutôt quelques réactions, des comportements révélateurs de leurs tempéraments respectifs, tous assez originaux, quoique dans des registres différents. Il n’est évidemment pas insignifiant que la comtesse décrite dans la première partie ait vécu sa maturité sous le fascisme mussolinien ni que la famille par alliance d’une de ses filles ait été menacée par les lois raciales promulguées après 1938 et peu vigoureusement combattues par l’Église. Quant à l’héritière de ces histoires croisées, elle est née au milieu des années 1960, elle est sensible aux films de Nanni Moretti comme son père l’avait été au jazz apporté par les libérateurs américains de 1944. Mais elle n’est pas seulement une représentante presque anonyme de cette génération qui a pu se trouver dans l’orbite des Brigades rouges ; elle nourrit une passion singulière pour la littérature russe, passion suffisamment puissante pour l’amener à apprendre en solitaire cette langue dans l’espoir de pouvoir en traduire les livres.
Aucune de ces trois femmes n’adhère tout à fait à l’image que l’on peut se faire d’une personnalité comme la leur. La comtesse a une telle volonté de conformisme réactionnaire qu’elle en vient à excéder le rôle même qu’elle tient tellement à jouer et passe des compromis redoutables – comme de vendre la précieuse bibliothèque familiale pour pouvoir tenir son rang aristocratique – ou dérisoires. Elle accepte finalement très bien que sa fille épouse un juif aisé pourvu que ce soit à l’église et qu’elle puisse y inviter toutes ses relations « qui comptent » dans la haute société, ce que le promis accepte sans hésiter, pour avoir la paix et parce que la religion lui est fondamentalement indifférente. Il y a deux choses que sa famille juive ne peut comprendre. L’une est que Mussolini s’aligne sur son disciple allemand et veuille s’en prendre aux juifs, lui qui a eu notoirement une maîtresse juive. Comment, de plus, peut-il oublier l’importante présence des juifs dans Rome, de longue date : bien avant que la papauté ne décide de tous les enfermer dans un ghetto. La deuxième chose que la tante Rachele et toute sa famille ne peuvent comprendre, c’est qu’une des nièces tienne absolument à partir s’installer en Israël, surtout maintenant que le risque de nouvelles lois raciales a disparu. Tous conjugueront leurs efforts pour la dissuader de s’obstiner dans ce projet qui leur paraît absurde. Finalement, ils réussiront à retarder son aliyah d’une dizaine d’années.
Quant à Laura, qui est annoncée dès le début du livre comme si elle devait en être l’héroïne, elle réagit certes au conformisme familial par une vie dissolue mais elle constate aussi qu’à l’heure critique – en l’occurrence, quand la gendarmerie vient l’arrêter pour complot contre la sûreté de l’État – elle peut compter sur le plein soutien de sa famille. On ne peut dire pour autant que sa révolte s’éteindra dans un verbalisme creux. C’est à la beauté de Rome qu’elle est sensible quand elle sort de sa pénible garde à vue.
Chacun à sa manière, les personnages principaux sont un peu à côté du rôle qu’ils jouent – ou que leurs familiers les voient jouer – et le charme du livre tient beaucoup au fait que cette non-adhésion est aussi, et même principalement, la position que prend le romancier à l’égard de ce qu’il raconte. Même à l’intérieur de chaque grande partie du livre, on n’est jamais devant un récit linéaire. La chronologie est bousculée puisque chacun des petits récits dont l’agencement constitue un portrait est censé éclairer un aspect de la personnalité considérée. Il n’est pas forcément la suite du précédent. L’enchaînement des propos est plutôt commandé par la logique des souvenirs qui s’appellent mutuellement en fonction d’associations d’idées qui peuvent de prime abord paraître arbitraires.
Un des plaisirs que procure la lecture de ce livre tient à l’art avec lequel le romancier s’efforce d’écrire à l’italienne. Depuis Stendhal, pour ne pas remonter jusqu’à la Pléiade, l’amour de l’Italie est un thème récurrent des lettres françaises, mais ce que l’on entend est généralement une voix française parlant de l’Italie. Dalembert a tenté autre chose : donner à entendre une voix italienne. Cela passe bien sûr par le fait de conserver en italien quelques mots comme palazzo ou contessa, et aussi plusieurs autres dont la traduction en français est moins évidente, à commencer par zia (« tante »). Ce ne serait qu’un procédé, certes efficace, si l’on ne sentait aussi toute une réflexion sur la langue et ses registres. Un chapitre est consacré à un débat familial autour du travail de Carlo Emilio Gadda sur les niveaux de langue dans L’Affreux Pastis de la rue des Merles. La comtesse ne peut admettre son usage de vulgarismes et surtout que « l’affreux sabir romain » soit ainsi élevé au rang de langue littéraire. En revenant sur ce débat vieux de six décennies, Dalembert rappelle à son lecteur l’importance que lui-même attache au jeu sur la différence des registres. C’est ainsi qu’il multiplie les notations sur la différence des parlers régionaux et sociaux, différence beaucoup plus sensible en Italie que ce que connaissent les francophones.
Cette finesse de la perception linguistique peut sans doute être mise en relation avec la polyglossie à laquelle notre auteur a été accoutumé entre le créole haïtien et le français, avant d’apprendre plusieurs langues étrangères dont, bien sûr, l’italien. On obtient ainsi une écriture d’une réjouissante modernité.