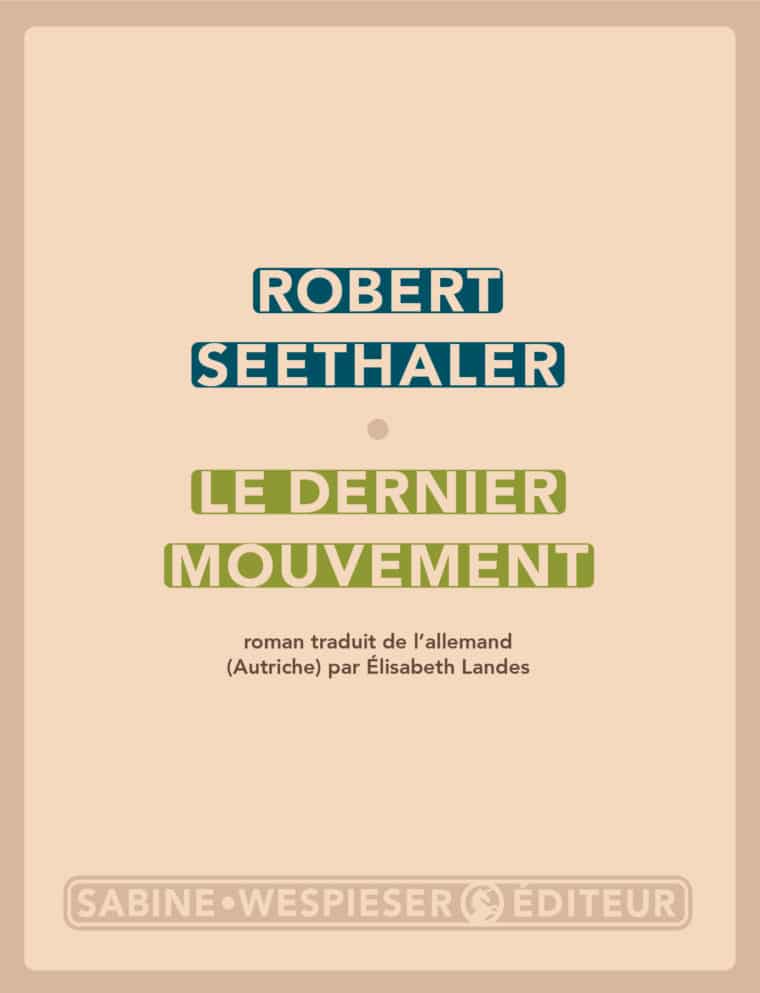
- Livre : Le Dernier Mouvement
- Auteur : Robert SEETHALER
- Revue de presse
TÉLÉRAMA.FR, entretien avec Christine Ferniot
Robert Seethaler : “La personnalité fascinante de Gustav Mahler m’a donné envie d’écrire ce ‘Dernier Mouvement’”
Malvoyant, l’autrichien ne s’imaginait pas devenir romancier. Pourtant, après avoir été comédien, il se consacre pleinement à l’écriture. Son dernier livre, consacré à l’artiste Gustav Mahler, est une œuvre forte, vivante et épurée. Rencontre.
Né à Vienne en 1966, dans une famille modeste, Robert Seethaler fut d’abord comédien. Une façon de conjurer le sort pour le jeune homme malvoyant qui voulait, explique-t-il, « être dans la lumière ». Mais, depuis une quinzaine d’années, il se consacre essentiellement à l’écriture. Après Le Tabac Tresniek, Une vie entière, Le Champ, il publie, toujours chez Sabine Wespieser, Le Dernier Mouvement, autour du musicien Gustav Mahler. Installé à Berlin, le romancier préfère le silence aux mondanités. Son nouveau livre est à son image, évitant le mot de trop, l’adjectif inutile. Il compose une œuvre forte, vivante, qui suggère plus qu’elle ne décrit. Mais lorsqu’il parle de son travail, de son parcours, Robert Seethaler ne se dérobe pas.
Le Dernier Mouvement prend pour héros le compositeur Gustav Mahler, mais comment écrit-on sur la musique ?
C’est un peu difficile à expliquer, car c’est un exercice d’équilibriste. Je ne voulais pas laisser à la musique de Gustav Mahler une place prépondérante, car on a déjà beaucoup écrit sur elle. Ce qui m’intéressait, c’était l’individu. Il était donc important que le texte développe sa propre musique. Le Dernier Mouvement est construit comme une symphonie. Vous savez, on ne peut pas rétrospectivement coller une musique sur un texte, il faut que le texte la génère. Un mot en entraîne un autre, mais il suffit qu’un mot ne soit pas juste pour que le rythme soit faux.
Un travail excessivement minutieux ?
Écrire est toujours un travail difficile. Pour moi il s’agit de rassembler chaque matin le foisonnement d’impression que je ressens, comme une étendue infinie. À moi ensuite de le ramasser, de m’en saisir et de le faire passer dans un étau disciplinaire pour en tirer quelque chose de sensé et d’exact. Cette exactitude exige une extrême concentration.
Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez entendu parler de Gustav Mahler en vous disant que, peut-être, un jour, vous écririez sur lui ?
La première fois, c’était il y a trente ans. Mais à l’époque, mon projet n’était pas d’écrire, c’était un sentiment, une sensation qui m’ont ému. Je crois que ça se passe comme ça pour moi. Quelque chose reste, comme une lueur qui chemine et, avec un peu de chance, si on y prête attention, il se développe quelque chose qui pourra donner lieu à une histoire. Je crois qu’on ne sait jamais de quoi va naître l’inspiration.
Vous avez toujours voulu écrire ?
Oui. Probablement, dès l’enfance. Mais je suis né dans une famille très modeste et je n’aurais jamais osé formuler ce désir. Même vis-à-vis de moi. C’était un univers trop lointain, comme si j’affirmais à mes parents : je veux être astronaute. J’étais dans une école de malvoyants car j’ai un problème de vision. Non, je n’aurais même pas osé me l’avouer à moi-même.
Quand on est malvoyant, ce qu’on ne distingue pas, on l’imagine. Donc j’imaginais beaucoup.”
Que s’est-il passé ? Un déclic, une personne ?
En fait, les portes de la création ont toujours été ouvertes. Quand on est malvoyant, ce qu’on ne distingue pas, on l’imagine. Donc j’imaginais beaucoup. Plus concrètement, j’ai commencé par écrire un scénario de film alors que j’étais comédien. Le scénario a eu un prix. Un auteur m’a conseillé d’écrire, et j’ai entrepris mon premier roman, qui a eu du succès.
Vous avez donc été comédien alors que vous étiez timide et malvoyant, quel pari téméraire !
Je n’ai jamais éprouvé de plaisir à être comédien. Il faut revenir à la préhistoire : j’ai passé mon enfance derrière d’énormes lunettes disgracieuses qui me complexaient. J’étais donc dans l’ombre et j’avais envie d’être dans la lumière, de dépasser cet état marginal en me plaçant sur le devant de la scène. C’était comme une fuite en avant. Mais à l’époque, je pensais qu’on pouvait se cacher derrière le rôle qu’on interprétait. Or pas du tout, car la gêne d’être exposé était infiniment supérieure au plaisir de me voir dans le regard du public. J’étais comme une blessure ouverte sur scène, c’était douloureux. Être regardé a quelque chose de très intime et de terrible, qui touche au dévoilement. Pour moi, c’était un sentiment de honte.
La littérature vous a-t-elle sauvé de tout cela ?
Sauver ? Un grand mot, pourtant c’est presque ça, car la littérature me donne la possibilité de rester au plus près de ce que je suis. Je ne suis pas obligé d’interpréter un rôle mais je peux quand même faire jouer mon imagination. Aussi, quand je dois m’exposer, expliquer ce que je fais, ce que j’écris, ça me met dans une situation délicate. J’essaye d’être honnête, je n’ai pas de réponse toute prête. Je n’ai pas de muraille pour me préserver mais ça m’oblige à clarifier ma pensée et à formuler certaines choses. C’est intéressant.
Si nous parlions des lieux de vos romans : un cimetière dans Le Champ, un café dans Le Tabac Tresniek, et surtout un bateau sur l’océan dans Le Dernier Mouvement.
D’une certaine manière, les lieux sont déterminants, mais ils ne sont que la surface des choses. L’essentiel ce sont les rencontres entre les personnes. Cela dit, j’affectionne les grands espaces, la montagne ou la mer se prêtent donc à mon univers. Gustav Malher passait sa vie à aller d’un lieu à l’autre, il était en mouvement et c’est ce qui m’intéresse, le mouvement.
Gustav Mahler est décrit sur le pont du bateau, assis sur un container, c’est une image marquante. D’où vient-elle ?
D’une part, il y a les faits. La documentation. Mahler a été effectivement installé sur le pont du bateau qui le ramenait de New York vers l’Europe. Mais était-il assis sur une caisse le dos à la paroi d’un container ? Ça, c’est moi qui l’ai vécu. Tout à coup, je me souviens avoir été adossé exactement comme ça au container. Mais quand je suis en train d’écrire, je n’y pense pas, je vois simplement que mon personnage ne peut pas être ailleurs. Je ne raconte pas une vie, c’est trop riche et ample. Imaginer une histoire, c’est comme un projecteur qui éclaire un moment.
Vous écrivez, rayez, réécrivez ?
Une fois que la phrase est sur l’écran, il est rare que je la reprenne. Mais je ne m’installe pas devant mon ordinateur pour écrire d’une traite. Il faut d’abord que je clarifie les images que j’ai en tête, que ça prenne le temps de mûrir, tout en menant ma vie par ailleurs.
N’aviez-vous pas peur de vous attaquer à un personnage aussi connu que Gustav Malher ?
Quand on a peur on n’écrit pas. Ce qui est important, ce n’est pas la façon dont les gens vont voir Malher, mais la façon dont Mahler voyait le monde. Je crée, je ne copie pas, je façonne un nouveau personnage. Il y a une maxime que je mets en pratique. Elle dit : fais ce qui t’intéresse. Gustav Mahler m’intéresse.
Depuis quand vous intéresse-t-il ?
Une histoire est comme un fleuve qui a beaucoup d’affluents, mais on peut parler d’une des origines du Dernier Mouvement. Elle remonte à un épisode lointain, environ trente ans. Ma première rencontre avec Mahler s’est faite à l’occasion d’un séjour d’une année dans un kibboutz, en Israël. Je travaillais dans les champs avec un rescapé de la Shoah un peu fou qui s’occupait de vieux chevaux. Il faisait une chaleur étouffante et je me souviens qu’il promenait son transistor dans la grange. Un jour, il a écouté la première symphonie de Mahler. Ce fut une rencontre déterminante avec le musicien. Cette histoire, cette image, ont mis trente ans à mûrir.
On en revient donc à la musique
Oui, il y a aussi la musique de Mahler. Pourtant je ne peux la supporter qu’à petites doses, car elle m’écrase. Mais je pense que c’est la personnalité fascinante du créateur qui m’a intéressé et donné envie d’écrire ce Dernier Mouvement. C’est un homme qui brûle sa vie et se donne entièrement. Nous avons des points communs : nous sommes viennois tous les deux, je suis un père de famille comme lui et moi aussi je me suis presque brûlé à une femme. Il y a aussi chez moi cette forte tension entre l’amour de la nature et le désir de la ville.
Je ne travaille en priorité ni sur la forme, ni sur les thèmes, j’écris à partir d’images et de sentiments. Quand on lui donne suffisamment d’espace, le sentiment se déploie et génère la forme. Il est là comme un être vivant qui se développe.
Lire l’entretien en ligne (éditions abonnés)