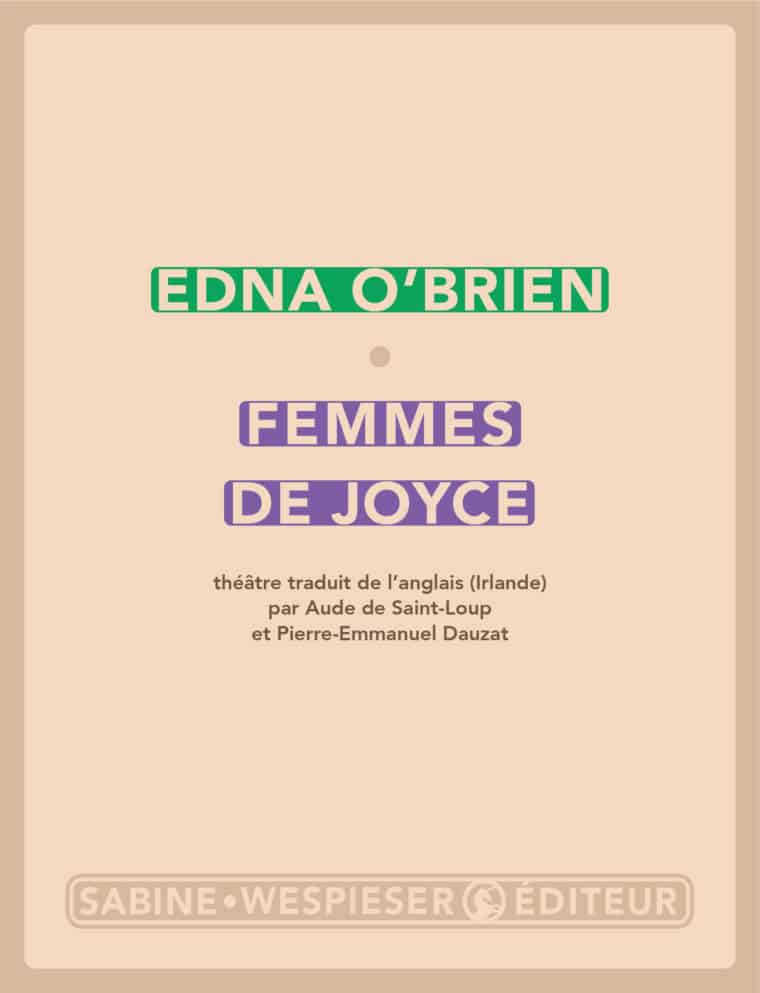
- Livre : Femmes de Joyce
- Auteur : Edna O'BRIEN
- Article complet
- Revue de presse
LE SOIR, Pierre Maury, dimanche 14 avril 2023
James Joyce entre toutes les femmes
Sous la forme théâtrale, Edna O’Brien revient sur l’écrivain qu’elle place au plus haut : « Femmes de Joyce ».
Edna O’Brien avait écrit James & Nora, un « portrait de Joyce en couple ». Elle n’en avait pas fini avec le plus emblématique et le plus complexe des écrivains irlandais – même si l’île a vu naître quatre lauréats du Nobel de littérature. Parmi eux, pas de James Joyce. Son roman majeur, Ulysse, était paru en 1922 en version originale (traduit en 1929), presque vingt ans avant la mort de l’écrivain, en janvier 1941 à Zurich.
C’est, pour l’essentiel, l’époque à la quelle Edna O’Brien situe Femmes de Joyce, ouvrage écrit pour le centenaire d’Ulysse et qui vient d’être traduit après avoir été monté à Dublin l’année dernière. Car il s’agit d’une pièce de théâtre, genre peu lu en général puisqu’il est fait pour être représenté en spectacle vivant. Mais il n’est pas interdit, et c’est même souhaitable, de faire des exceptions quand, comme ici, le texte prend déjà vie sur la page.
Joyce, dont Edna O’Brien fait son « héros absolu » depuis soixante ans, est au centre d’un chœur où se multiplient des voix diverses, parfois discordantes. Toutes ne sont pas féminines. La première à s’exprimer est celle d’un certain Zozimus, qui chante un air traditionnel irlandais pendant lequel les personnages autour desquels s’articuleront les scènes entrent silencieusement en scène – on y reviendra. Le chant de Zozimus, explique l’autrice, « est le fil conducteur de la pièce. » Il surgit en contrepoint, ici et là. Puis arrive Stanislaus Joyce, frère cadet de l’écrivain, avant que celui-ci s’attable pour écrire en citant ses propres textes. Ceux-ci formeront une trame pardessus laquelle s’élaborent les autres récits enchevêtrés.
Une atmosphère de luxure
Enfin, avant l’intervention des protagonistes dont les noms sont importants, quatre filles, distinguées seulement par un numéro, entament un débat ironique sur la sexualité de Joyce. « Sa bite roupille. » Il s’agit de prostituées qu’on ne reverra plus mais dont la présence, dans cette scène d’introduction, crée une atmosphère de luxure. À l’exact opposé de ce qui se pratique officiellement en Irlande catholique.
Revenons aux six femmes qui justifient le titre de la pièce et lui donnent son âme. Il y a May Joyce, la mère de l’écrivain (un spectre), Nora Barnacle, sa femme, Lucia Joyce, leur fille, Brigitte Zimmermann, logeuse du couple à Zurich, Martha Fleischmann, qui aima Joyce, et Miss Weaver, généreuse mécène. Les fragments biographiques surgissent comme un collage auxquels répondent les extraits de Finnegans Wake, d’Ulysse, d’autres œuvres, de lettres. Chacune joue un rôle entre la compassion pour celui qui va bientôt mourir et l’agressivité envers ce qu’il représente. Même Nora, la chère Nora, reconnaît qu’elle n’a jamais pu lire un seul de ses livres, ce que James n’ignorait pas puisqu’il confiait à Stanislaus : « Elle se fiche de mon art. »
Art contesté avec vigueur par des hommes qui interviendront plus tard, jusqu’à cette sentence extrême : « Moi, ce que je dis, c’est pendez l’hérétique. » Art qui, quand même, a mis Dublin sur la carte, rappelle un autre : « Faudrait lui élever une statue… » Tous les avis sont là, les anecdotes abondent, Joyce est vivant.