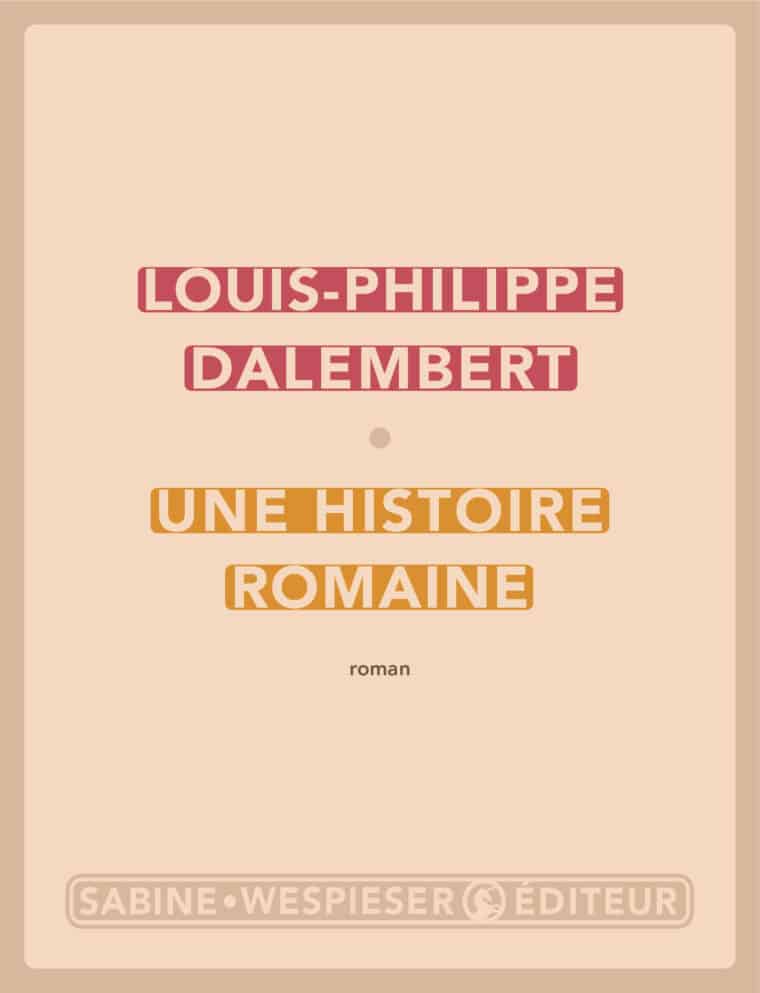
- Livre : Une histoire romaine
- Auteur : Louis-Philippe DALEMBERT
- Revue de presse
BABELIO, chronique de Kirzy, jeudi 12 octobre 2023
Lire l’article sur le site Babelio
Voici le roman de la famille de Laura Sabatelli Guerrieri de Pretis, « une Romaine d’origine protégée » née en 1965 de deux lignées aux racines profondément ancrées dans la ville éternelle, l’une aristocrate, l’autre juive. Pour la raconter, Louis-Philippe Dalembert propose un récit extrêmement vivant réparti en trois parties qui se répondent et s’enrichissent mutuellement. La dernière est consacrée à Laura, les deux premières à deux formidables personnages de matriarche.
D’abord, la grand-mère maternelle, la contessa, qui veille farouchement à l’héritage moral et matériel de sa famille d’aristocrates désargentés, toute obnubilée par la nécessité de tenir son rang et sauver les apparences malgré les revers de fortune. Puis la grand-tante, mémoire vivante du coté paternel, recluse en ses appartements par un embonpoint qu’elle soigne à coups de dragées et gâteaux débordant de ses poches, en compagnie de son chat ainsi des grands écrivains et musiciens russes.
Ce sont elles les stars du roman, ainsi que la ville de Rome en elle-même, magnifiquement décrites. On se régale à la description des lieux, rive droite et rive gauche, ainsi qu’à l’évocation de l’histoire italienne : montée du fascisme, Seconde guerre mondiale et sort des Juifs italiens, Dolce Vita puis années de plomb. On se délecte des très nombreuses références à la culture italienne, notamment littéraire et cinématographique.
Lorsque Laura arrive en scène, elle semble bien palote à côté de ses deux figures tutélaires écrasantes. Mon intérêt a nettement piqué du nez dans la troisième partie. Les enjeux sont pourtant passionnants, Laura éprouvant des difficultés à se trouver une place, ni sur une rive du Tibre, ni sur l’autre, tiraillée par les contradictions de son double héritage aristocrato-juif.
Autant, j’ai aimé rire et voyager dans Rome grâce aux deux premières parties, autant dans la dernière j’avais besoin d’émotions et de vibrer pour cette jeune femme en quête d’identité. Mais, je n’ai rien ressenti pour elle, trouvant le récit beaucoup trop froid avec sa narration en surplomb qui crée une distance très cérébrale entre le personnage et moi, la lectrice.
Le vrai plaisir de lecture n’a pas résidé pour moi dans le déroulé du récit en triptyque mais dans la formidable écriture de Louis-Philippe Dalembert, déjà repérée dans ses précédents romans, et qui ici pétille de façon délicieuse en de sinueuses phrases qui révèlent la truculence des situations avec un sens du tempo comique particulièrement réjouissant.
(A la mort de son volage de mari, la contessa préfère le confort du veuvage, malgré nombreuses propositions de remariage ) :
« Au-delà de la crainte de lier les dernières années que Dieu lui concédait de vivre à un tire-flanc libertin et de l’imposer, qui pis est, à ses enfants et petits-enfants, elle n’avait nulle envie d’exposer aux yeux d’un inconnu sa nudité chiffonnée – elle n’était pas si décatie non plus. En dernière analyse, si elle n’avait pas connu, bibliquement parlant, que le père de ses enfants, se faire secouer tel un prunier par un érotomane, au moment de se mettre au lit en quête d’un sommeil bien mérité, ne lui manquait pas le moins du monde, sauf à tisser une liaison qui viendrait l’aider à redorer les lustres ternis au fils des ans … On n’était jamais à l’abri d’une bonne surprise. »