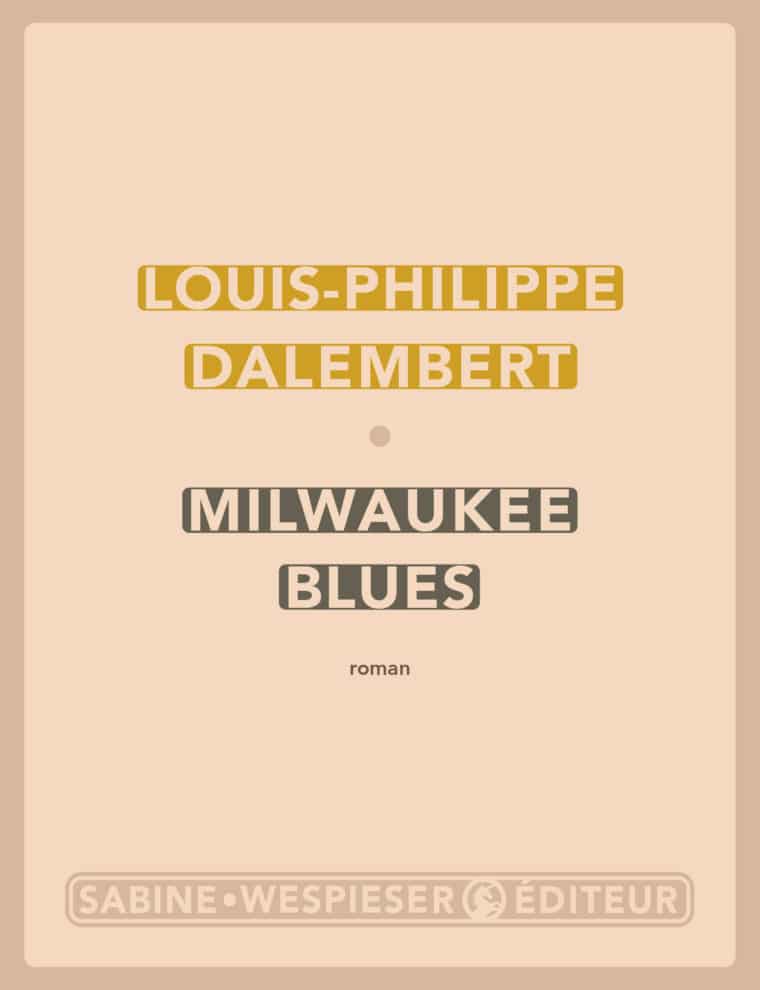
- Livre : Milwaukee Blues
- Auteur : Louis-Philippe DALEMBERT
- Article complet
- Revue de presse
JEUNE AFRIQUE, Anne Bocandé, samedi 23 octobre 2021
« Bouleversé par le meurtre de George Floyd, l’auteur haïtien raconte dans Milwaukee Blues les États-Unis d’aujourd’hui, où le communautarisme fait le jeu d’un capitalisme brutal.
Ancrée dans les enjeux politiques de notre époque, la littérature de Louis-Philippe Dalembert humanise les trajectoires individuelles derrière les drames. Après Mur Méditerranée, qui retraçait le parcours de trois femmes africaines vers l’Europe, et Ballade d’un amour inachevé, sur un tremblement de terre en Italie, le romancier-poète haïtien s’empare du sujet des violences policières racistes aux États-Unis pour dépeindre l’Occident malade d’un capitalisme mortifère avec Milwaukee Blues, qui figure dans la première sélection du prix Goncourt 2021. Rencontre.
Jeune Afrique : Quel a été l’élément déclencheur de ce roman ?
Louis-Philippe Dalembert : Depuis longtemps, j’ai l’envie d’écrire un roman qui se passe aux États-Unis. Le meurtre de George Floyd a été le déclencheur de l’écriture : un homme noir tué par un policier blanc en mondovision. C’est un sujet qui me trotte dans la tête depuis 2014, lorsqu’à New York, Éric Garner a lui aussi été tué, plaqué au sol par plusieurs policiers blancs. Il a lui aussi prononcé ces fameux mots : “Je ne peux pas respirer.”
Dans votre précédent roman, Mur Méditerranée, vous humanisez des personnes réduites à un vocable réducteur. Avez-vous suivi la même dynamique ?
J’ai écrit un roman à partir d’un fait divers et d’un homme que tout le monde croit connaître. Il s’agit de remettre la personne dans une histoire, la sienne, celle de sa famille. Le rendre à son humanité. Mon personnage, qui n’est pas Floyd, grandit dans un ghetto sans père, avec une mère très pieuse. Il est doué en football américain. Il pense pouvoir échapper au déterminisme social. Sauf que le rêve américain se termine en cauchemar. Non pas au moment où il est assassiné, mais quand des accidents l’empêchent de devenir professionnel. Il va alors accumuler les petits boulots…
Pourquoi avoir choisi le roman choral pour dessiner le portrait de cet homme noir, Emmett, tué par un policier blanc à Milwaukee ?
Je ne voulais pas tomber dans le manichéisme et dresser un tableau plus vaste des États-Unis. Le roman commence avec la mort d’Emmett. Une multitude de personnes vont le raconter. Je commence par le point de vue de l’épicier pakistanais, rongé de remords. C’est lui qui a appelé la police. Dans ce chapitre, il parle aussi de sa “communauté”, de son quartier. Il y a ensuite les voix de tous ceux qui l’ont connu : la vieille institutrice, ancienne soixante-huitarde, venue des beaux quartiers blancs. Puis ses deux amis d’enfance, son ancien coach et son ex-petite amie blanche. La troisième partie, celle de la marche, est la seule écrite à la troisième personne, avec un chapitre où je me glisse dans la peau du policier. Il est dépassé, il ne s’attendait pas à ce que ce soit retransmis partout et que le monde s’acharne sur lui.
“La littérature ne saurait exister en dehors de son temps”, écrivez-vous. Est-ce le journaliste devenu romancier qui parle ?
J’ai commencé à lire de la prose à l’adolescence avec de grands auteurs russes qui venaient d’un autre siècle, d’un autre pays et qui me parlait jusque dans les Caraïbes. Pour atteindre cette intemporalité, je crois qu’il faut écrire dans les échos de son temps. Pour moi, il n’y a de littérature que de l’humain. C’est la raison pour laquelle je peux écrire un roman qui se passe aux États-Unis, ou comme avec Mur Méditerranée, me mettre dans la peau de femmes qui viennent du Nigeria, d’Érythrée et de Syrie.
Dans le roman, c’est le personnage de Ma Robinson qui semble porter ce message…
Cette ancienne gardienne de prison, noire, âgée, devenue révérende, comprend le cri de colère des Noirs. Elle comprend aussi les Blancs qui parfois préfèrent dire : “Je ne veux pas de problèmes, ça ne me concerne pas.” Mais elle insiste : tout ce qui est humain nous concerne. Comme disait John Donne, au XVIIe siècle : “Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est une partie de l’ensemble.” Il termine par : “La mort de tout homme me diminue, parce que j’appartiens au genre humain ; aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas : c’est pour toi qu’il sonne.”
Rien de ce qui est humain, en tant qu’artiste, ne me devrait être inconnu. On ne peut remédier à un certain nombre de problèmes, seuls, en dressant une communauté contre une autre. On peut trouver ça ingénu, mais je veux croire en cette utopie que nous nous sauverons ensemble ou nous périrons tous.
J’ai envie de croire en l’humanisme de Ma Robinson. Comme Martin Luther King dans “I have a dream”, je veux croire en cette utopie qu’un jour on puisse s’assoir tous ensemble, sans distinction de race, de religion ou de sexe. Quand j’étais ado, j’étais plus proche de Malcolm X mais, comme lui, je me suis rapproché avec le temps de l’utopie de Luther King. Mais je ne suis pas encore prêt à tendre l’autre joue.
Quel est votre rapport aux États-Unis ?
C’est un pays qui fait partie du roman familial. Comme beaucoup d’Haïtiens, j’entends parler des États-Unis depuis l’enfance. Avant même le pays, il y avait New York. Les oncles, tantes, cousins, tout le monde y allait. J’y ai de la famille depuis les années 1960. J’ai enseigné à l’université de Wisconsin-Milwaukee et au Street College, en Californie. Encore aujourd’hui, l’Amérique me fascine et me dérange. On a l’impression que c’est le pays de tous les possibles. L’épicier pakistanais le dit au début du roman ; même si on finit par crever, on crève avec l’espoir et il n’y a pas pire que de crever sans espoir.
En même temps, il y a énormément de choses qui me dérangent à commencer par un communautarisme avec beaucoup de tensions. Cela masque, à mon sens, l’essentiel, à savoir un capitalisme ultra brutal qui laisse de côté les plus faibles, les plus pauvres. Et plus on est divisé, plus ce système peut perdurer. L’extrême morcellement de la société étasunienne fait l’affaire d’un capitalisme à visage inhumain. Je connais ces mondes en fréquentant tout autant ceux qui ont réussi le rêve américain et ceux qui peinent à joindre les deux bouts.
À qui s’adresse ce roman très documenté sur l’histoire des États-Unis et des luttes ?
Il s’adresse à ceux qui ne comprennent pas ce pays et à ceux qui ont tendance à enfermer les peuples dans une case. Et aux jeunes, très présents dans le livre. Je me revois à leur âge avec cette fougue et ce sentiment que le monde commence avec nous. Or il n’a pas commencé là, il faut en prendre conscience tout en gardant la volonté de changer les choses. Il faut connaitre le passé pour aller vers le futur, pour qu’advienne un “plus jamais ça”, pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Je suis dans une continuité de combats.
La musique et la littérature prennent beaucoup de place dans ce roman. Que peut l’art dans les luttes ?
La musique et la littérature accompagnent les jeunes dans le roman. Cette jeune Haïtienne de Chicago est fascinée par Danticat et Toni Morrison. La musique les aide à tenir. Je suis moi-même fasciné par le blues, le gospel, le jazz. Et puis le rire, qui est partout aussi, permet d’avancer. Le rire n’est pas une façon de cacher ni un manque de lucidité, il nous dit que nous sommes encore vivants. »