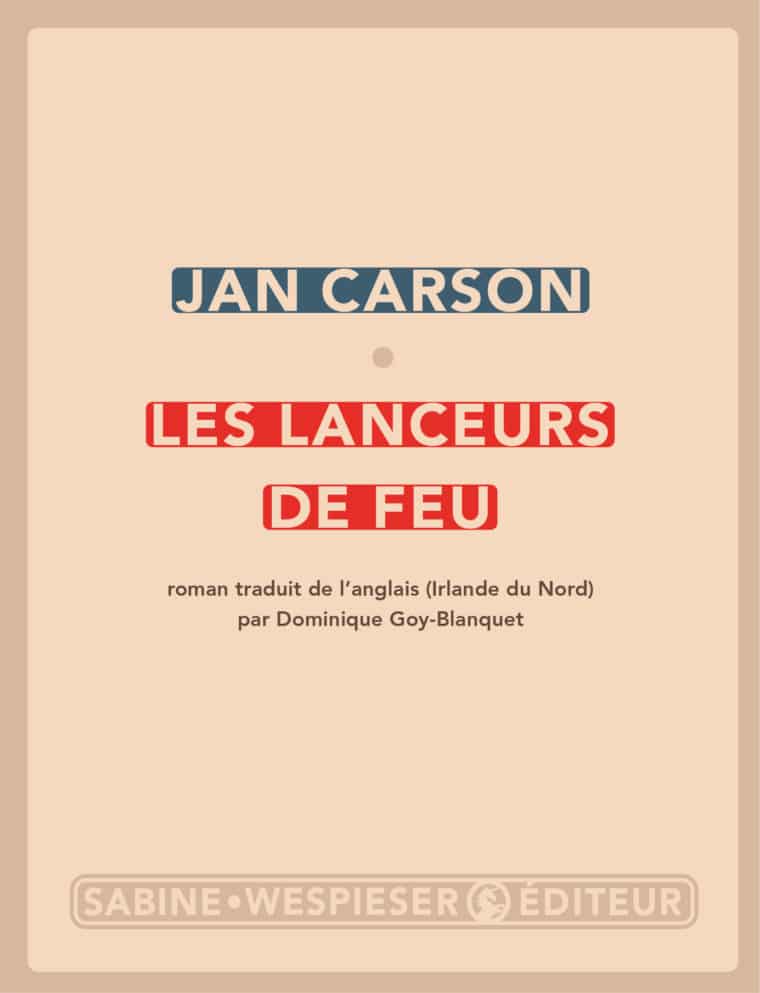
- Livre : Les Lanceurs de feu
- Auteur : Jan CARSON
- Article complet
- Revue de presse
LIBÉRATION, Frédérique Roussel, samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
« Jan Carson : “Utiliser le réalisme magique dans le contexte de l’Irlande du Nord”
Un terne médecin, un ex-paramilitaire protestant ou une sirène : la romancière Jan Carson, figure d’une nouvelle génération d’écrivains nord-irlandais, décrit dans Les Lanceurs de feu un Belfast-Est encore traumatisé par trente années de Troubles.
Belfast, été 2014. Les Troubles devraient être terminés depuis l’accord de paix de 1998. “C’est ce qu’on nous a dit dans les journaux et à la télévision. Ici nous sommes très portés sur la religion. Nous avons besoin de tout croire par nous-mêmes. (On a tous tendance à enfoncer les doigts dans la plaie et bien fouiller autour.) Nous ne l’avons pas cru dans les journaux ni à la télévision. Nous ne l’avons pas cru dans nos os. Après tant d’années assis sur une position, nos épines dorsales s’étaient figées. Il nous faudra des siècles pour les déplier.”
Terminés ? Pourtant dans les rues de Belfast Est, cet été-là – le roman s’étale de juin à août –, de gigantesques incendies démarrent déclenchés par des silhouettes en jeans et capuche de survêtement. Il se joue une séquence de tension aiguë qui restera comme «l’Été des grands feux». Et dans ce bain brûlant, au bord de l’explosion meurtrière, Jan Carson suit deux personnages : Jonathan Murray, un médecin terne et coincé, seul avec son bébé depuis que sa compagne éphémère et sirène addict de la baignoire a disparu ; et Sammy Agnew, un ancien activiste protestant et sanguinaire contre les catholiques, désormais repenti, qui découvre que son fils Mark est le chef d’orchestre des émeutes en cours, derrière des vidéos en ligne attisant la violence. “J’ai peur de toi, maintenant, fiston, comme j’ai peur de l’homme violent qui dort en moi, comme j’ai peur de mes propres points et leur façon de se serrer sans que j’y pense chaque fois que je me tiens immobile.”
Dans ce décor incandescent et ravageur, l’angoisse des deux protagonistes vis-à-vis de leur progéniture tourne à la hantise destructrice. Jan Carson glisse dans cet univers à la fois criard extérieurement et perturbé intérieurement des notes de merveilleux, des enfants oiseaux, poissons, vampires… Êtres aimés par leurs parents mais patauds comme des albatros, inadaptés à la vie. Rien de véritablement innocent, juste du Stabilo fluo pour montrer combien sont profondes les racines du mal, que le présent peine à expurger. Entretien avec Jan Carson, 41 ans, lors de son passage à Paris en septembre.
Comment avez-vous eu l’idée de ce roman ?
Je voulais écrire sur l’Irlande du Nord contemporaine, sur l’impact des Troubles (le conflit nord-irlandais) à Belfast-Est où je vis, pour que le décor soit littéralement devant ma porte et parce que c’est une partie de la ville presque à 100% protestante. Il y a moins de récits protestants dans la littérature nord-irlandaise que de récits catholiques. Nous sommes vus comme les méchants et les outsiders de l’histoire. Le récit hollywoodien américain a toujours été celui du nationalisme. Si vous regardez des films ou des émissions qui mettent en vedette l’Irlande du Nord, c’est toujours le côté catholique qui est montré. Je veux raconter l’autre côté.
Pourquoi les deux personnages principaux sont-ils des hommes ?
Les voix masculines me viennent plus facilement que les féminines. Mais c’est surtout chez les hommes qu’a été observé un impact important des Troubles comme des problèmes de santé mentale. Il y a littéralement eu une épidémie de suicides en Irlande du Nord, liée à l’intimidation paramilitaire, la perte de proches ou les conséquences économiques. Cette détresse a été principalement constatée chez les hommes parce qu’ils gardent tout à l’intérieur. Les femmes échangent davantage entre elles. Animatrice artistique communautaire depuis 1998, je l’ai vu dans les ateliers d’écriture que j’anime. J’ai travaillé avec des groupes de gens aux parcours formidables. Par exemple, le personnage de Sammy, l’ex-paramilitaire, est un composite de toutes les souffrances et de tous les espoirs que ces pères ont pour leurs enfants et pour la génération suivante.
Belfast représente vraiment un personnage à part entière.
Absolument. Quand j’y suis arrivée adolescente et jusqu’à mes 25 ans, j’en ai eu vraiment marre de vivre dans cet endroit. L’Irlande du Nord est incroyablement petite et on a l’impression parfois de grandir dans un bocal de poissons rouges. J’ai vécu en Amérique pendant quatre ans, à Portland, dans l’Oregon. Et j’ai haï Belfast quand je suis revenue pour des raisons professionnelles en 2010. Pour surmonter cette détestation, je me suis mise à écrire en observant les gens de très près et en me plongeant dans des projets communautaires. Ce processus d’écriture de proximité m’a fait tomber amoureuse des lieux. L’autre aspect, qui est difficile à comprendre à moins d’y avoir grandi, c’est qu’il y avait peu de choses en Irlande du Nord, les groupes ne venaient pas faire de concerts en raison du danger. Peu de cafés étaient ouverts après cinq heures. C’était comme grandir dans une arène de conflit. Et cela a vraiment été excitant de voir débarquer des festivals et des touristes du monde entier.
Où avez-vous grandi ?
Je suis originaire de Ballymena, qui n’est pas un endroit idéal pour grandir. C’est très protestant, de classe moyenne et rurale. Mes parents sont des presbytériens extrêmement conservateurs et mon père, qui vient de mourir, était dans le clergé de l’Église presbytérienne. Ils ne s’impliquaient pas dans la politique, ne votaient pas. Je suis le mouton noir de la famille. Il y a certaines parties de mon éducation pour lesquelles je suis reconnaissante et d’autres, comme le légalisme et la rigueur – ne pas boire, ne pas danser – que je ne trouvais vraiment pas drôles du tout. Il m’a été agréable de m’en éloigner. A 18 ans, j’emménageais à Belfast lorsque l’accord de paix du Vendredi saint [accord de paix pour l’Irlande du Nord signé le 10 avril 1998, ndlr] a été signé. J’ai l’impression d’avoir été aux premières loges de ce qui s’est passé en Irlande du Nord depuis lors.
Pourquoi avoir choisi cette temporalité de trois mois d’été ?
C’est la période où une grande partie de la communauté unioniste, l’Ordre d’Orange, parade dans les rues avec des feux de joie. Cela crée évidemment des tensions. Tout le trafic s’arrête, personne n’ose sortir, il y a des gens saouls et du bruit partout. Les émeutes se produisent généralement pendant cette période. Lorsque les enfants retournent à l’école en septembre, c’est presque comme ranger les décorations de Noël… C’est un peu dire : c’est fini pour les émeutes, on se revoit l’été prochain.
Pourquoi vos deux pères ont-ils un problème avec leur enfant ?
Je voulais aborder la question de l’héritage. Les jeunes en Irlande du Nord sont nés juste avant ou après l’accord du Vendredi saint. Ils n’ont aucun souvenir du conflit et présentent pourtant des signes de traumatisme. Cette idée de ce qui se manifeste dans la génération suivante, post-conflit, est vraiment intéressante. J’ai voulu explorer à quel point une génération est responsable de la suivante. C’est aussi un problème biblique. J’ai grandi avec l’Ancien Testament et il y a beaucoup d’images bibliques dans Les Lanceurs de feu, comme le père sacrifiant le fils ou le père qui s’inquiète de l’héritage qu’il a laissé à son enfant. Quand on écrit, les choses sortent parfois des parties les plus profondes de notre psychisme.
Pourquoi avoir utilisé le réalisme magique ?
J’ai lu énormément de textes de réalisme magique avant d’être écrivain, puis j’ai écrit des textes qui contenaient souvent un élément fantastique. J’aime beaucoup des auteurs comme Gabriel García Márquez, Günter Grass et Salman Rushdie, qui utilisent des éléments magiques pour traiter des questions sociales et politiques difficiles à aborder de front. Si beaucoup de textes existent sur les Troubles, je voulais utiliser des éléments magiques comme une sorte de choc pour inciter les gens à se réveiller. On a demandé un jour à Flannery O’Connor, l’une de mes autrices préférées, pourquoi elle se servait du grotesque dans son écriture. Elle a répondu cette chose étonnante : pour les presque aveugles, vous utilisez de grandes images et pour les malentendants, vous criez. C’est mon point de départ pour utiliser le réalisme magique dans le contexte de l’Irlande du Nord. Les gens en ont déjà entendu parler ? J’ai besoin de faire quelque chose d’un peu plus fort et d’un peu plus surprenant pour qu’ils se réveillent.
Votre deuxième personnage de père, Jonathan, paraît tout d’abord très passif.
Jonathan, c’est moi. C’est le personnage que j’ai imaginé dans tout ce que j’ai écrit qui soit le plus proche de moi. En Irlande du Nord, nous avons le mot “dour” qui veut dire presbytérien, terne et pas drôle. C’est ainsi que Jonathan grandit avant de faire cette rencontre avec le merveilleux, une sirène. Pour moi, cela a été la découverte avec l’art, à 16 ans, quand j’ai ouvert Les Hauts de Hurle-Vent. Toutes les lumières se sont allumées.
Faites-vous partie d’une nouvelle génération d’écrivains ?
Dans les vingt dernières années, depuis le Traité de paix de 1998, il y a eu une montée de nouvelles voix dans la littérature en prose de l’Irlande du Nord, en particulier à Belfast, où il y a une très forte tradition de poésie du fait de Seamus Heaney. Certains abordent les Troubles d’une manière très frontale, d’autres davantage les thèmes de leur héritage et de leur impact, d’autres encore privilégient le point de vue de la jeunesse. La série Derry Girls se concentre ainsi sur quatre adolescentes qui ont grandi pendant les Troubles. Il existe également une littérature queer étonnante sur ces sujets, par exemple The Good Son, de Paul McVeigh, qui porte sur le fait de grandir quand on est un jeune gay dans le quartier nationaliste d’Ardoyne, là où le Milkman d’Anna Burns est situé. Ce sont des voix que nous n’avions jamais entendues auparavant. Après l’accord du Vendredi saint, de nombreux éditeurs avaient prédit que personne ne voudrait plus entendre parler de l’Irlande du Nord… Ces nouvelles perspectives montrent bien que toutes les histoires n’ont pas été racontées. D’autant que nous sommes toujours aux prises avec les conséquences du conflit, des problèmes d’équilibre mental, de pauvreté et de violence qui mijotent sous la surface.
Quelles autres fictions contemporaines sont dans ce sillage ?
Glenn Patterson écrit sur ces thèmes depuis le début des années 80. The Truth Commissioner, de David Park, aborde ces questions sur une base plus contemporaine. Michael Hughes a publié il y a environ trois ans l’étonnant Country, qui revisite l’Iliade mais dans un contexte nord-irlandais. Le recueil de nouvelles Sweet Home de Wendy Erskine traite aussi des tensions à Belfast-Est. Beaucoup d’auteurs s’emparent du matériel historique d’une manière nouvelle. L’universitaire Caroline Magennis vient de publier un essai sur ce sujet, en août dernier, Northern Irish Writers After the Troubles, Intimacies, Affects, Pleasures (Bloomsbury) qui analyse cette renaissance littéraire et la créativité de la nouvelle génération d’écrivains. Mais on a l’impression que les deux communautés, catholique et protestante, commencent à fusionner certaines de leurs préoccupations, universelles, comme l’environnement, la classe sociale et l’emploi. Et nous n’avons pas l’impression qu’il y ait une réelle différence.
Est-ce une sorte de littérature post-conflit ?
Quand on se trouve au cœur d’une guerre civile, il est très difficile d’en parler directement. J’ai pu écrire ce roman librement sans être menacée, ce qui n’aurait pas été le cas il y a trente ans. Il est possible aujourd’hui d’analyser ouvertement des choses dont il était difficile de parler dans les années 70 et 80. Cela n’est pas fini. Je vis dans une région où le taux de chômage, le taux de pauvreté sont parmi les plus élevés du pays, et où demeure une énorme présence paramilitaire. Le Brexit a énormément tendu la situation ces deux dernières années, et nous avons pu le voir au printemps avec les émeutes. S’il y a le sentiment que les problèmes majeurs sont terminés, la question de l’Irlande du Nord – partie de l’Irlande ou partie du Royaume-Uni ? – n’a pas été résolue.
De quoi parle votre dernier roman qui vient juste d’être publié ?
The Raptures (Penguin) se passe en 1993 dans ma région d’origine. Il s’agit d’un incident survenu dans une école primaire locale, qui n’est pas lié au conflit nord-irlandais. Beaucoup d’enfants ont commencé à tomber malades et certains même en sont morts. Il s’agit de savoir comment ce petit village réagit à la tragédie, comment un grand chagrin est traité par une communauté. C’est mon texte le plus autobiographique, et j’ai un peu peur.
Pourquoi ?
Parce que c’est très honnête. Il s’agit en grande partie du milieu religieux dans lequel j’ai grandi. J’aime ma famille et ma communauté, mais je veux me poser en ami critique, qui dit les choses belles comme négatives. C’est un jeu d’équilibre difficile. Beaucoup de choses ont été dites sur l’Église catholique en Irlande, très critiques dans la plupart des cas. En revanche, on a peu écrit sur l’Église protestante et je pense qu’il est temps de commencer à parler de choses qu’elle a faites, ainsi que des paramilitaires protestants et des politiciens. J’ai grandi dans un milieu où l’art était pécheur. Comme l’Église perd de son emprise, il y a une explosion de voix protestantes qui s’expriment. »