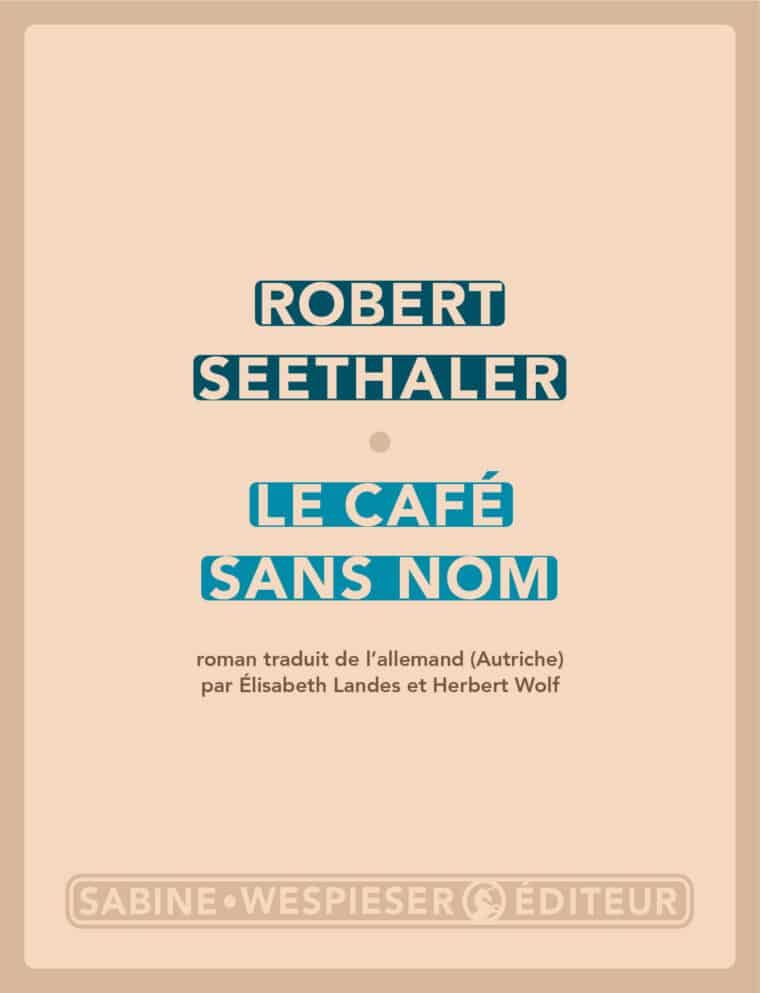
- Livre : Le Café sans nom
- Auteur : Robert SEETHALER
- Article complet
- Revue de presse
LIBÉRATION, portrait par Virginie Bloch-Lainé, samedi 4 novembre 2023
Rencontre avec le romancier berlinois d’adoption, autour du «Café sans nom», situé à Vienne dans le quartier des Carmélites où l’auteur a grandi.
Né en 1966, année à laquelle débute son cinquième roman, Le Café sans nom, le Viennois Robert Seethaler est très grand, très beau. Berlinois d’adoption, célèbre et reconnu Outre-Rhin, il était à Paris pour quelques jours au mois de septembre. Dans le bureau de son éditrice, Sabine Wespieser, c’est cet homme réservé et observateur qui a commencé à poser des questions, précises, signe notamment d’une curiosité d’écrivain. Aux questions qu’on lui adresse en revanche, il a d’abord répondu succinctement. Comment qualifierait-il le caractère de Robert Simon, le héros, patron débutant d’un café décati dans le quartier populaire viennois des Carmélites ? « Il n’y a qu’à lire le livre, tout est dedans. Ma réponse est sincère, car c’est à travers le travail de l’écriture que j’ai dit qui était Robert. Le décrire à l’oral, de l’extérieur, ce n’est pas possible. C’est au lecteur de se faire activement une idée. » Robert Seethaler est un praticien et un maître de l’ellipse. Il est tourné vers l’intérieur et pourtant il effleure les sensations, il éclaire délicatement les moments furtifs où ses personnages font un bilan d’étape avant de reprendre le cours de l’existence. Cette économie de l’écriture s’accompagne, autre paradoxe, d’une constante douceur. Elle est étrangère à la sécheresse.
Journalier sur le marché, Robert Simon, qui fut enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, signe donc le bail d’un café désaffecté. Il n’en devient pas propriétaire, c’est un point important. Le lieu, auquel Robert ne trouve pas de nom, de même qu’il n’impose jamais rien à personne, va se remplir de clients peu à peu, au fil des pages, tandis que Vienne, plongée dans le noir et dans la poussière, balayée par les cendres des décombres au début du roman (« À Vienne, on compte autant de têtes de morts que de pavés »), se relève, se ressaisit. Seethaler n’en dit jamais davantage sur les horreurs de la guerre mais il glisse plusieurs allusions à ce qui est rangé sous le tapis et qui est immonde. Le roman raconte, sur une quinzaine d’années, la vie du troquet et celle de quelques-uns de ses habitués : entre autres, un boucher, avec lequel Robert Simon noue une amitié et une solidarité profondes, émouvantes, et la serveuse du café, Mila, une femme à l’allure d’enfant abandonnée lorsque Simon la rencontre et qui se révèle solide, heureuse, et fiable. Elle épouse un client du café, René, catcheur, très amoureux d’elle, redoutant avant de l’aborder de ne pas lui plaire. Robert Seethaler : « René est naïf, et je ne mets rien de péjoratif dans cet adjectif. La naïveté consiste à se demander comment les choses pourraient marcher entre lui et Mila, et à essayer de la séduire. Cela nécessite beaucoup de courage. Quand on aime, il faut du courage. » René est catcheur sous les applaudissements du public pendant l’été et le reste de l’année, au Prater, il vend des billets et travaille comme aboyeur aux autotamponneuses.
Le quartier des Carmélites, depuis lequel on aperçoit le Prater, la fameuse grande roue de Vienne, est celui dans lequel Seethaler a grandi. « Ma famille en vient. Mes grands-parents sont des exilés du pays des Sudètes, situé à la frontière avec la Moravie. Ils sont arrivés à Vienne dans un état de grande pauvreté, ils vivaient dans un sous-sol. Mes parents ont eux aussi habité ce quartier et j’y ai été élevé dans mes premières années. Le roman est une façon de revisiter cet endroit. Avant la Seconde Guerre mondiale, c’était le quartier ouvrier et juif. Il n’y a presque plus de juifs à Vienne désormais. Maintenant c’est l’un des quartiers les plus gentrifiés. » Le motif de la roue court tout au long du roman. Les saisons tournent, la neige embellit Vienne, et la poussière qui s’envole au début du livre fait son retour à la fin. L’ouverture du café est célébrée par une fête ; le local se ferme sur une autre fête.
Comment l’écrivain parvient-il à une telle épure ? Retranche-t-il des mots du premier jet de son texte ? « Je n’écris pas cent pages pour ensuite passer l’élagueuse. Je place un mot, et ce placement va m’indiquer si le reste tombe juste. Un terme bien installé commence à briller et me rassure sur le reste. Il faut aussi se souvenir que je vois très mal : j’ai été opéré plusieurs fois des yeux et scolarisé dans une école pour malvoyants. Mais paradoxalement, je suis extrêmement visuel et mes romans commencent sur une image originelle. C’est donc une question de regard. Je vois les choses avec les paupières closes et je les observe développer leur propre réalité. » L’image originelle du Café sans nom est la suivante : Robert Simon colle son front à la vitre de l’ancien café du marché des Carmélites. Il « scruta l’intérieur en plissant les yeux. Les tables et les chaises étaient empilées devant le grand comptoir sombre. La couleur du papier peint avait passé, et à certains endroits il se gondolait. On aurait dit que les murs avaient des visages. Ils ont besoin d’air, se dit Simon. »
Les personnages inventés par Seethaler sont vaillants. Ils ont du mérite : « Ce sont souvent des personnes incertaines. Mon idéal d’écriture est que toute phrase soit un étonnement, que derrière chacune, se tienne cette question, “Qui es-tu ?”. Je représente un milieu social de gens dits simples, et j’insiste sur le “dits”, car en réalité rien n’est simple, pour personne. C’est mon milieu d’origine, il m’intéresse, je le connais bien. Ce sont des personnes qui font des efforts pour sortir la tête de l’eau, qui déploient beaucoup d’efforts pour éviter de se noyer. Elles exercent un métier physique qui leur donne une dimension sensible et que je n’aurais pas si je ne les définissais qu’à travers leurs pensées. »
Le Café sans nom est magnifique dans les portraits qu’il dresse. Robert Seethaler entretient des incertitudes tout en faisant preuve d’une constante acuité à ce que les êtres construisent en partie volontairement, pour partie inconsciemment. Ainsi, une relation conjugale se consolide au fil des ans et prend « une certaine forme d’évidence ». Le livre est mélancolique mais les histoires d’amour n’y finissent pas toujours mal, au contraire.