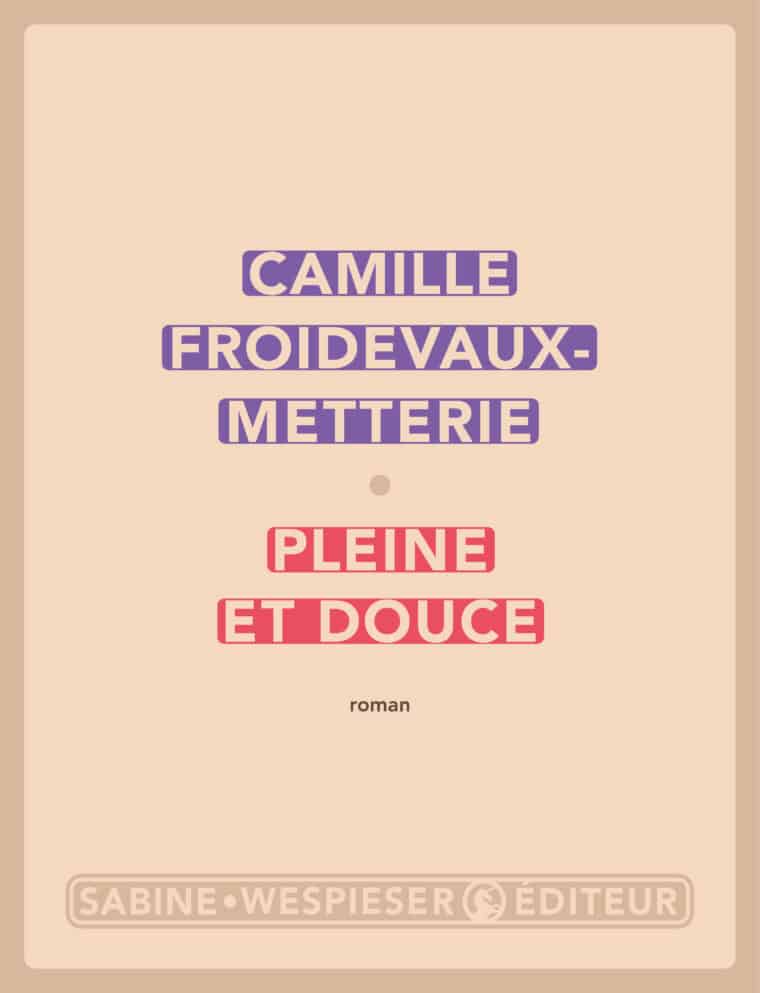
- Livre : Pleine et douce
- Auteur : Camille FROIDEVAUX-METTERIE
- Article complet
- Revue de presse
PHILOSOPHIE MAGAZINE, Cédric Enjalbert, mai 2023
Figure d’un renouveau du féminisme, la philosophe Camille Froidevaux-Metterie a récemment fait paraître un premier roman, Pleine et Douce. Elle y poursuit une ambition politique et éthique: incarner subjectivement la pensée, lui donner corps, sans rien lâcher de l’universalité du droit.
Dans son bureau, deux grandes bibliothèques se font face. L’une est consacrée à la philosophie, l’autre à la pensée féministe. Entre elles, un petit bureau, un guéridon encombré de livres et un lit. Une chambre à soi. C’est ici que la philosophe Camille Froidevaux-Metterie a écrit ses essais et son nouvel ouvrage, un roman intitulé Pleine et Douce. Elle y déploie le cœur de sa réflexion sous une forme fictionnelle et polyphonique, à travers une douzaine de voix féminines, à laquelle se mêle souvent la sienne, entre les lignes. Le cœur ou le corps, car il s’agit bien pour elle, qui s’est engagée aux avant-postes du féminisme, de revenir à une pensée incarnée. Professeure de science politique enseignant à l’université de Reims, elle tient ensemble les dimensions philosophique, historique et sociologique de ce qu’elle a appelé « la révolution du féminin ». Une nouvelle vague qui s’inscrit dans la chronique de l’émancipation des femmes, entamée avec la bataille du vote au XIXe siècle, puis celle de la procréation dans les années 1960, du travail dans les années 1980, de la famille en 1990 et, enfin, du genre dès 2000, jusqu’à faire éclater la binarité des rôles masculin et féminin. Désormais, la convergence des genres a abouti à la féminisation de l’espace social et à la masculinisation (en cours) de la sphère intime… mais ce progrès masque une perte collatérale. Ce grand oublié, c’est le corps. Or Camille Froidevaux-Metterie en a fait un enjeu primordial de la lutte féministe et de la réflexion philosophique, convaincue que les avancées en matière de droit avaient laissé (stratégiquement) dans l’ombre tout un pan de l’expérience vécue, comme une étape nécessaire d’abstraction, faisant des femmes des « hommes comme les autres ». Mais l’affaire Weinstein et le vaste soulèvement contre les scandales sexuels qui s’en est suivi sous la bannière #metoo ont mis en lumière l’objectivation persistante du corps féminin qui reste « à disposition ». « C’est ainsi, écrit-elle, que, par-delà l’irrésistible des avancées sociales et de l’égalisation des conditions, l’intimité sexuelle est demeurée hors du champ des droits fondamentaux. » Cependant, le vent tourne. « De façon éparse et presque insidieuse », via la dénonciation des violences gynécologiques, la sensibilisation à l’endométriose ou la redécouverte du clitoris, par exemple, le corps féminin a « investi le débat public ». Le corps s’est enfin rendu visible… et Camille Froidevaux-Metterie s’est lancée dans cette « bataille de l’intime » !
Que représente la parution d’un premier roman dans votre parcours intellectuel et personnel ?
Je travaille depuis une dizaine d’années à la diversification des modes d’expression de la pensée philosophique et politique. Dans une première version d’Un corps à soi, j’avais imaginé des ouvertures de chapitres sous forme de textes fictionnels incarnant les thématiques corporelles ensuite étudiées. Cette proposition hybride n’était peut-être pas la plus pertinente, mais j’ai surtout compris que j’avais un désir de fiction qu’il fallait que j’assume, sans le dissimuler dans mes essais. J’avais écrit ce que je devais du point de vue théorique et philosophique dans l’essai, j’ai pu alors ouvrir un espace proprement littéraire.
Un corps à soi fait référence à Une chambre à soi de Virginia Woolf ; Pleine et Douce emprunte à son « flux de conscience ». Quel rapport entretenez-vous à cette autrice ?
Elle est au sommet de mon Panthéon littéraire, l’une des rares autrices que je relis. J’apprécie la pluralité de ses registres d’écriture : essais, romans, nouvelles, que l’on trouve aussi chez Simone de Beauvoir. Quand on écrit sur la condition féminine, il faut mobiliser tous les outils disponibles : si le projet féministe veut réinventer les relations amoureuses et sexuelles, il doit aussi passer par des propositions littéraires.
Dans Un corps à soi, vous empruntez à la philosophe Natalie Depraz la notion de « phénoménologie expérientielle » pour qualifier ce rapport singulier à la philosophie, qui met en avant la première personne, un « je ». Pourquoi ?
Écrire à la première personne, c’est revivre une expérience spécifique et la partager. C’est un chemin d’incarnation. Une forme de cohérence épistémologique m’engage à ne pas faire l’économie de la parole des femmes, la mienne comme celle des autres. Dans La Révolution du féminin, je passais déjà au « je » de façon homéopathique, en expérimentant cette démarche phénoménologique. La philosophie, telle qu’elle se pratique de façon immémoriale, s’écrit à la première personne du pluriel : c’est le « nous » du penseur en surplomb, selon une conception très idéaliste, qui s’imagine répandre ses lumières sur le monde. La pratique phénoménologique nous rapatrie sur Terre, puisque le sujet pensant est non seulement incarné mais aussi situé dans une époque et un lieu donnés. La phénoménologie féministe ajoute une brique supplémentaire en considérant que les sujets pensants incarnés sont aussi sexués et qu’ils pensent à partir de cette sexuation. Cette approche rompt avec l’idéalisme mais elle est également une manière de se saisir d’objets inédits dans l’histoire de la philosophie, des objets issus de l’« expérience vécue » du corps féminin, comme les seins, les règles ou le corps enceint. Je parle à ce propos de « nœuds phénoménologiques », soit tous ces bouleversements corporels qui produisent des effets simultanément intimes, sociaux et politiques, impliquant une modification du rapport à soi, aux autres et au monde. L’ouverture d’un tel champ de pensée n’est pas destinée à produire une pensée circulaire, écrite par des femmes pour des femmes. Car penser le corps des femmes revient à penser la condition incarnée en général en explorant des notions universelles, comme la vulnérabilité ou la disponibilité corporelle. Par ailleurs, je ne prétends pas que les hommes n’accordent aucune importance à leur corporéité, ni qu’ils échappent aux injonctions sociales – la pression à la performance, notamment –, mais j’affirme que leur corps ne détermine pas, a priori, les modalités de leur être-au-monde, n’étant pas immédiatement synonyme de discriminations et de violences comme l’est le corps des femmes.
Peut-on revenir un instant sur la genèse de ce féminisme phénoménologique ?
J’y suis venue par la philosophe américaine Iris Marion Young, en lisant un recueil de textes, hélas ! inédit en français, intitulé On Female Body Experience [« De l’expérience du corps féminin »]. Elle m’a fait « découvrir » Beauvoir, que je connaissais sans l’avoir lue avec application. Young raconte comment elle l’a d’abord trouvée hostile à la question du corps – il y a effectivement des pages rageuses sur la maternité dans Le Deuxième Sexe. Puis elle l’a relue à la lumière de ses propres réflexions, en repérant qu’il s’agissait en fait de la première proposition de phénoménologie féministe. La pensée de Simone de Beauvoir est assurément très liée à celle de Maurice Merleau-Ponty – ils s’écrivaient toutes les semaines durant la rédaction du Deuxième Sexe. Pour lui, « mon existence comme subjectivité ne fait qu’un avec mon existence comme corps ». Pour elle, « la femme n’est pas une réalité figée, mais un devenir », elle doit accomplir sa destinée de liberté dont on la prive en la réduisant à son corps procréateur. Quant à l’apport de Young, il est de considérer que nous sommes des corps situés au sein d’une société marquée par des contraintes visant spécifiquement les femmes: division sexuée du travail, hétérosexualité normative et hiérarchies genrées de pouvoir. Young propose de considérer « les femmes » comme un collectif politique permettant de conceptualiser l’oppression en tant que processus systémique et institutionnalisé. Mais, pour ne pas tomber dans le piège d’une artificielle uniformisation, elle réfléchit le genre comme une structure « sérielle » – le terme est de Jean-Paul Sartre. Les femmes forment une série, écrit-elle, en tant qu’elles « sont des individus qui sont positionnés comme féminins par les activités entourant ces structures et ces objets » forgés par l’histoire patriarcale. Il existe des dizaines d’autrices qui travaillent dans la perspective du féminisme phénoménologique, notamment aux États-Unis et en Scandinavie, mais très peu en France, ce qui m’a amenée à cette interrogation : où est passé le corps des femmes dans la pensée féministe française ? Depuis les années 1980, il a disparu des préoccupations et n’est plus alors demeuré qu’une lecture étroite de Beauvoir, dont on a abusivement fait une proto-théoricienne du genre. Or, si les femmes sont devenues des individus de droits investis dans le domaine social et professionnel, elles n’en ont pas moins continué d’être des sujets définis d’abord par leur vie sexuelle, conjugale et maternelle. C’est-à-dire des corps « à disposition ».
Comment avez-vous découvert la réflexion d’Iris Marion Young, morte prématurément d’un cancer, à 57 ans, en 2006 ?
On était au début des années 2000, la concomitance de la naissance de mon fils et d’un premier poste à l’Université a produit en moi une déflagration. Le fait d’advenir à la condition contemporaine de sujet accompli, légitime dans la sphère sociale, tout en restant une mère, avec ce que cela impliquait d’injonctions à la perfection maternelle, m’a fait réfléchir à cette dualité qu’éprouvent les femmes. Je me suis tournée vers ce qu’écrivent mes collègues sociologues et politistes à ce sujet, à un moment où, en France, on découvrait les études de genre – Trouble dans le genre de Judith Butler a été traduit en 2005, quinze ans après sa parution. La maternité et, de façon plus générale, l’expérience vécue des femmes étaient absentes de la réflexion. Dans le système de pensée hérité des années 1970, deux féminismes s’opposaient : universaliste et différentialiste. Quand La Révolution du féminin est paru, en 2015, le livre a immédiatement été étiqueté différentialiste, voire essentialiste. Comme je voulais réhabiliter la maternité en tant qu’objet de pensée et de lutte féministe, on me suspectait de vouloir ré-enfermer les femmes dans leur corps. Or le féminisme phénoménologique ouvre une troisième voie. Il prend en compte l’aspiration des femmes à l’égalité des droits en tant que sujets démocratiques, tout en considérant le corps féminin sous ses deux aspects : simultanément le lieu d’une domination et le vecteur d’une émancipation. Je m’efforce de déployer cette approche phénoménologique en l’augmentant des apports des études de genre et de la pensée queer.
Vous avez employé le terme de « sexuation » plusieurs fois. Peut-on le définir ?
J’entends par là le processus de construction de soi par lequel nous choisissons de faire de notre devenir corporel ce que nous voulons, par une appropriation réflexive des déterminations biologiques et culturelles. Je n’ai pas inventé la distinction entre les attributs sexuels biologiques, prétendument naturels, qui permettent d’assigner les individus à la naissance, et la construction historique et sociale des stéréo- types de genre. Je propose de penser les caractéristiques sexuées dans la perspective d’un monde où les rôles et les compétences ne seraient plus genrées. Il faut partir du fait qu’à l’adolescence, l’entrée des filles dans la sexuation féminine est pour elles synonyme d’une entrée dans la condition de corps-objet, avec tout ce que cela implique de discriminations et de violences. Elles sont alors immédiatement objectivées et aliénées, rendues étrangères à elles-mêmes, et le resteront pour toutes les dimensions incarnées de leur existence. Dans Un corps à soi, je déroule le fil de l’existence des femmes pour observer comment, à chaque tournant corporel, se combinent la logique patriarcale d’objectivation et l’aspiration féministe à la réappropiation de soi. Comment repenser l’apparence, la sexualité, la maternité au prisme de la liberté ? Comment revenir au corps des femmes pour l’extirper du carcan patriarcal, sans l’essentialiser ? Comment sortir de la binarité des sexes et des genres pour définir un individu enfin générique ?
Comment fait-on ?
On écrit des livres, on fait des podcasts, on descend dans la rue. C’est là qu’interviennent les féministes engagées dans ce que j’ai nommé la « bataille de l’intime », qui ont entrepris de reprendre possession de tous les sujets corporels. Depuis une dizaine d’années, cette nouvelle génération se ressaisit de tous les sujets, en réinvestissant l’intimité corporelle. Cela a commencé avec les règles, au début des années 2010, puis il a été question des organes génitaux, du plaisir et de la sexualité, ce qui a débouché sur la séquence de dénonciation des violences sexuelles autour de #metoo; ce sont ensuite les thèmes liés à la maternité qui ont été investis, et c’est aujourd’hui le vieillissement et la ménopause. J’ai parlé à ce propos de « tournant génital du féminisme ».
Si le corps est le lieu d’une lutte dialectique entre l’émancipation et l’aliénation, quand la bataille sera-t-elle gagnée ? Quel idéal se donner ?
L’horizon du féminisme, c’est de faire advenir un monde où les femmes ne seraient plus des corps et où, plus largement, les individus ne seraient plus définis par leurs caractéristiques corporelles. Prenons l’exemple du corps enceint, peut-être le plus polémique, mais qui montre bien ce dont il est question. Si l’on découple la gestation du corps féminin et si l’on dit qu’un homme peut être enceint, ce qui est désormais le cas – je veux parler des grossesses des hommes trans –, on comprend ce que signifie cette neutralisation corporelle qui est visée. Cela peut paraître lointain, voire inenvisageable pour certains, mais ce sont des réalités vécues et non plus des abstractions. Plus de la moitié des enfants naissent aujourd’hui dans des familles dont le socle n’est plus un couple hétéro marié. En revanche, l’acceptation sociale prendra du temps, et il faudra savoir répondre à ce que les sociologues appellent la « panique morale ». Pour s’en convaincre, il suffit de voir les réactions disproportionnées à l’ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes ou les diatribes rageuses contre les « déconstructeurs » et le « wokisme ».
Après avoir interrogé les hommes sur leur rapport au féminisme, vous avez entrepris le même exercice auprès des jeunes. Qu’avez-vous découvert ?
J’avais théorisé un tournant générationnel que j’imaginais accompli chez les trentenaires. J’ai découvert avec Les Mâles du siècle que ce n’était pas si flagrant… En revanche, pour une bonne part des garçons de 7 à 18 ans, les questions de sexualité et de genre ne sont plus un « problème ». Pour eux, elles sont dépassées, comme évidentes.
Peut-on parler de « philosophie de terrain », lorsque vous enquêtez ainsi ?
En début de carrière, dans ma sous-discipline de la philosophie politique, il y avait peu de postes. Je m’apercevais qu’à chaque audition passée pour être recrutée, on attendait de moi que je sois d’abord sociologue politique. Mais on n’attendait pas des sociologues qu’ils aient le même degré de connaissance en philosophie, et je trouvais cela très injuste ! Cela dit, concrètement, j’ai été amenée à faire du terrain, notamment une enquête sur les femmes politiques dont les résultats ont été restitués sous la forme d’un docufiction, Dans la jungle. C’est alors que j’ai mesuré la valeur heuristique de la parole intime. Je me suis aperçue que de partager mes difficultés à être à la fois mère et prof produisait des effets utiles pour la recherche. Mes interlocutrices se sentaient peut-être mieux comprises. En tout cas, elles acceptaient de se livrer. J’ai ainsi spontanément pratiqué le « cercle de conscientisation » théorisé et vécu par les féministes des années 1970. Je prolonge cette méthode artisanale qui combine sociologie politique, phénoménologie expérientielle et mise en partage féministe… Ce n’est pas très orthodoxe, mais cela me permet d’explorer mes sujets au plus près !
Vos recherches portent initialement sur le rapport entre la religion et le monde moderne, sur le sociologue Ernst Troeltsch [1865-1923] et les États-Unis. Qu’en reste-t-il ?
Lorsque j’étais étudiante à Sciences-Po, j’ai découvert un recueil de textes intitulé Protestantisme et Modernité de Troeltsch, qui était un contemporain et un ami de Max Weber. Sa grande histoire du rapport des chrétiens à la réalité sociale, économique et politique, des origines évangéliques jusqu’au XIXe siècle, m’a passionnée. Dans ses Doctrines sociales, traduites dans quasiment toutes les langues mais pas en français, Troeltsch élabore une typologie des façons pour les chrétiens d’être au monde : la mystique individuelle, repliée sur sa vie spirituelle, en retrait du monde ; la secte ou le groupe convaincu d’incarner une forme de sainteté et de supériorité morale ; l’Église, qui a vocation à imprégner le monde des valeurs chrétiennes. Après mes études doctorales en Allemagne, j’ai poursuivi avec un « postdoc » à l’université de Chicago, sur le rapport entre politique et religion aux États-Unis. Il m’a paru intéressant de montrer que, contrairement à ce que les Français s’imaginent, les États-Unis ne sont pas une théo-démocratie. L’ordonnancement politico-religieux y est plutôt structuré par une opposition entre une conviction laïque, héritée des Pères fondateurs, et une aspiration sociale théocratique, le tout lié par une « religion civile ». Je continue aujourd’hui d’être fascinée par la vie politique américaine que j’enseigne. Mon prochain roman aura d’ailleurs les États-Unis pour cadre et le féminisme américain en toile de fond.
Comment s’est formé votre goût pour la philosophie ?
Il n’y a pas vraiment de tradition intellectuelle dans ma famille. Le goût pour l’écriture me vient d’abord de la lecture. Je lis des romans quotidiennement, depuis toujours. Mon père était architecte, mon grand-père aussi, pour les Monuments historiques. Ma grand-mère paternelle était sculptrice ; son frère était professeur de français et avait écrit un petit livre sur Rousseau. Les origines de la famille Froidevaux se trouvent à Paris, mais j’ai personnellement passé toute ma jeunesse à Nevers, du temps où Pierre Bérégovoy était maire. Si l’on veut me mettre une étiquette, disons que j’ai eu une éducation « catho de gauche ». Du côté de ma mère, le milieu était plutôt populaire. Mon grand-père maternel était apprenti maçon quand il est entré dans la Résistance, puis il est resté dans l’armée. J’ai reçu de ma mère une éducation assez raide. Les femmes de sa génération n’ont pas eu d’autre choix que de rentrer dans le jeu patriarcal, alors elles ont éduqué celles de ma génération – je suis née en 1968 – pour qu’elles deviennent des hommes comme les autres, souvent au mépris de tout le reste. Ma mère avait un rapport critique à tout ce qui paraissait féminin. Je me suis construite contre cet interdit, mais de façon douloureuse, parce que je souffrais d’hyperphagie et que j’ai été une jeune femme grosse. Il m’a fallu un long cheminement, qui est passé par le féminisme phénoménologique, pour trouver un rapport apaisé à mon corps.
Dans le champ de toutes vos activités, l’une semble manquer, c’est la politique. Y songez-vous ?
Pas du tout ! J’ai développé une distance critique, voire un dégoût pour la vie politique française…
Qu’a-t-elle de dégoûtant ?
On m’interroge rarement à ce sujet, mais j’enseigne d’abord la science politique. J’observe que les partis progressistes n’ont jamais sérieusement intégré le projet féministe à leur programme, ils se contentent d’y parsemer quelques mesures égalitaires, de lutte contre le sexisme ou contre les violences, sans jamais considérer la dimension systémique du problème. La responsabilité de la désaffection civique revient à ces hommes et à ces femmes qui ont littéralement dégoûté les citoyens de la question politique en en faisant une simple compétition entre individus pour l’accès au pouvoir. Cependant, j’observe avec espoir l’apparition d’une nouvelle génération militante qui se déploie à distance des partis.
Que signifierait être de droite ou de gauche, aujourd’hui ?
Être de gauche, c’est reprendre le projet à l’origine : le souci de la redistribution, la réduction des inégalités et la mise en cohérence de ses convictions avec ses actions.
Que pensez-vous de l’inscription du « droit » ou de la « liberté » de recourir à l’interruption volontaire de grossesse [IVG], dans la Constitution ?
Je la soutiens, bien sûr, même s’il faut se méfier d’une éventuelle « arnaque à la liberté ». J’ai écrit à ce sujet une tribune à six mains avec la sociologue Nathalie Bajos et la juriste Stéphanie Hennette-Vauchez. Elles m’ont fait prendre conscience que la vraie question sémantique n’est pas celle de la liberté ou du droit, mais celle de la « garantie ». Selon la première formulation, la loi « garantissait le droit fondamental » à l’IVG ; selon celle révisée par le Sénat, elle doit « déterminer les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Si elle les détermine, elle peut donc aussi les restreindre. Aux États-Unis, quasiment la moitié de la population féminine se trouve désormais dans l’impossibilité de recourir à l’avortement. Il est important que la France garantisse cette liberté dans la Constitution, parce que les droits reproductifs assurent bien plus que la maîtrise par les femmes de leur corps procréateur, ils sont la condition de leur statut de sujets de droits : comment être aussi libres et égales que les hommes quand on subit des grossesses non désirées ou que l’on risque sa vie à avorter dans des conditions clandestines ? Quand on dit cela, on comprend que l’on doit aux féministes des années 1970 d’avoir fait entrer les femmes dans la modernité démocratique !