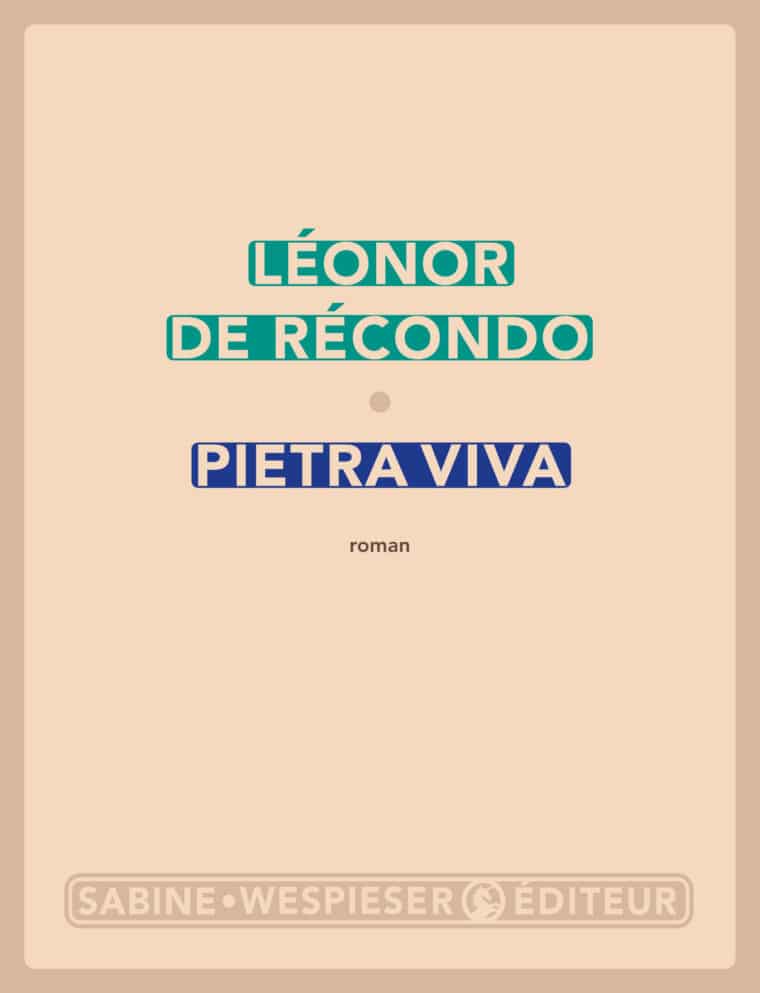
- Livre : Pietra viva
- Auteur : Léonor de RÉCONDO
- Article complet
- Revue de presse
LE MONDE DES LIVRES, Léonor de Récondo, Le Monde des livres, Assises Internationales du Roman, vendredi 16 mai 2014
« Le mystère Michel-Ange »
« Ce qui se cache, d’après moi, derrière les mots : Imaginaire, romanesque et biographie, c’est la brèche du sensible. Cet interstice infime dans lequel le romancier va s’insérer pour toucher le personnage, malgré l’image prédéterminée par notre inconscient collectif et culturel. Dans le cas de Michelangelo, le personnage existe déjà, il est illustre. Pourtant, j’ai décidé d’écrire un roman et non un essai. Pour cela, il a fallu que je me détache des faits pour me rapprocher de l’émotion, il a fallu que je me place justement là où mon imaginaire pouvait se glisser : dans les silences, dans les non-dits, dans l’impalpable de ce personnage.
Ma rencontre avec Michelangelo s’est faite lorsque j’avais 5 ans et que mes parents séjournaient régulièrement à Pietrasanta, en Toscane, pour sculpter. J’allais voyager ainsi entre l’Italie et la France pendant dix ans. Dix années marquées par la beauté des villages, de la pierre, du marbre, des chefs-d’œuvre de la Renaissance. Étrangement, Michelngelo, même si je savais sa renommée, partageait notre vie quotidienne. Mes parents allaient tous les soirs boire un verre au bar… Michelangelo. Non loin, sur l’une des maisons de la place du village : une plaque gravée indiquait qu’à cet endroit précis le maître avait signé un contrat. Dans les ateliers de marbre, les artisans faisaient des copies de la Pietà et du David pour des musées étrangers ou de riches collectionneurs. Michelangelo était là, présent à chaque instant, mais de ses œuvres, je ne connaissais que des copies.
La vraie rencontre a eu lieu quelques années plus tard, quand j’avais dix ans et que j’ai visité la chapelle Sixtine pour la première fois. Je m’en souviens parfaitement. Elle venait tout juste d’être restaurée, les couleurs étaient éclatantes. J’avais un petit miroir pour regarder le plafond sans me tordre le cou et j’étais bouleversée par la force de cet homme seul, en haut de son échafaudage, avec ses pinceaux et ses couleurs, qui avait créé cette fresque cinq siècles auparavant. J’ai pensé : C’est donc toi qui as fait tout cela ? Toi que je connais ? Toi dont tout le monde parle ? Cette présence familière, qui m’avait accompagnée jusque-là, prenait soudain une teinte différente, plus mystérieuse. Et lorsque ma mère m’a montré sur la fresque du Jugement dernier, à côté du Christ en gloire, un corps grisâtre, sans os, au visage défait, en me disant : C’est lui, c’est Michelangelo !, mon émotion a été si forte, mon interrogation si profonde quant au fait qu’il se peigne laid, alors qu’il n’avait eu de cesse de nous offrir tant de beauté, que j’en ai eu le souffle court.
Le roman commence toujours là où le souffle est court. Là où il faut écrire pour comprendre, pour distinguer plus nettement les contours de cette figure qui nous intrigue. Dans le cas de Michelangelo, la littérature a été très prolixe. J’ai lu et je me suis documentée. Mais il y avait quelque chose que je devais comprendre par moi-même. Et l’unique moyen était d’écrire sur lui. De parcourir avec lui le chemin de la carrière, de le voir marcher, sculpter, douter. Je ne suis pas sûre d’en savoir plus aujourd’hui, peut-être même que mes interrogations sont plus nombreuses. Mais le roman sert-il à répondre à une question ? À des questions ? Je ne le crois pas non plus. D’après moi, il s’agit d’un voyage intérieur, sensible, lors duquel on se rapproche dangereusement de l’autre, quel qu’il soit : personnage, lecteur ou soi-même. »