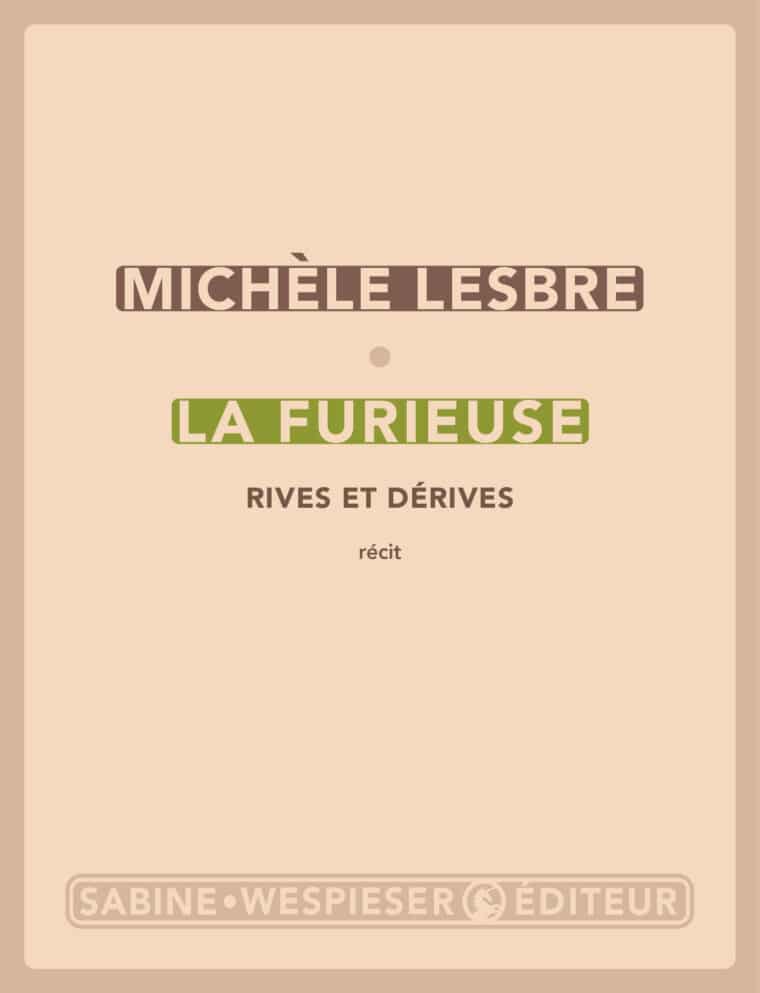
- Livre : La Furieuse
- Auteur : Michèle LESBRE
- Article complet
- Revue de presse
LA CROIX, Emmanuelle Giuliani, jeudi 2 février 2023
Dans ce nouveau récit, admirable, Michèle Lesbre tisse des liens indestructibles entre le voyage intérieur, l’amour de la littérature et le désir d’ailleurs.
Retour vers l’inconnu
« Je la reconnaissais sans la connaître, toute douce, ce jour-là. Printanière, pimpante, elle chantonnait. » Objet d’une quête, ardente et déterminée, la Furieuse, rivière du Doubs attachée à la vie et l’œuvre du peintre Gustave Courbet, porte bien mal son nom, lorsque Michèle Lesbre la découvre enfin. L’écrivaine ne l’en aime pas moins, s’attardant sur ses rives, remontant son lit vers sa source sauvage. Et, déjà, dans un jeu fascinant ouvrant la cassette aux souvenirs, ici flous, là précis, le cours d’eau français l’emporte vers Cuba, Belfast ou l’Ukraine agressée.
Dans ce récit divaguant dont on se surprend à souligner au crayon une phrase sur deux (au moins !) tant elle sonne juste dans sa simplicité poétique et sa profondeur sans effet de manches, il est question du passé et du présent, du réel et de la littérature. Les références aux auteurs d’hier et d’aujourd’hui abondent sans que le lecteur se sente exclu, bien au contraire : la plume toujours à la main, il note avec gratitude le titre de tous ces ouvrages qu’il n’a pas encore ouverts. À l’instar de Jean-Paul Kaufmann, qu’elle cite d’ailleurs, Michèle Lesbre se place ainsi au point cardinal entre expérience personnelle et portée universelle. Ses mots frappent, discrets mais imparables, au cœur de notre humanité, comme un hommage à Simenon « dont (je) ne me lasse pas de la littérature qui fouine si bien dans la vraie vie ».
De ses nombreux voyages, sur les quais de Seine ou au bout du monde mais toujours avec l’eau d’un lac, d’une mer ou d’une rivière en ligne de mire, elle retient des images, des sons et des parfums. Ils se mêlent aux amours enfuies et à une forme de mélancolie dépourvue d’amertume. Certes, notre monde mécanisé et rapide, « bolide aveugle et sourd », ne lui plaît guère mais elle évite soigneusement de « revisiter les chagrins » et, surtout, possède maintes et maintes ressources pour s’en évader. À commencer par la réminiscence vivace et réconfortante des moments passés à la campagne près de Roanne, en bordure d’un petit étang, dans la maison de Léon et Mathilde, ses grands-parents.
À rebours des fleuves, la mémoire est si libre, si habile à remonter le temps ! Elle s’abreuve aux traces laissées, aux lettres trouvées après le décès des aïeux, révélatrices de leurs liens secrets. « Celles de mon grand-père étaient d’une belle écriture stylée, romantique et empreinte de désir, celles de ma grand-mère étaient plus maternelles, conseillères, attentives et prudentes, où la passion, si elle existait, était en retenue. »
La mémoire, antidote béni au prosaïsme, œuvre aussi comme « les pêcheurs à la ligne (qui) tentent désespérément de ralentir le monde », se livrant, pacifiques et patients, à un « sport de combat immobile ». On devine — on espère — le demi-sourire flottant sur les lèvres de l’écrivain quand elle pose sur la page de telles notations, dignes des riches heures du style français, des moralistes sans pédanterie de l’Ancien Régime. Elle en a hérité, n’en déplaise à son âme progressiste et sociale, le même talent d’observation, des autres et de soi-même, la même indulgence lucide née d’une longue pratique, des autres et de soi-même. Et la même envie de partager le fruit de son cheminement sur les berges de l’existence, en compagnie des autres et de soi-même.