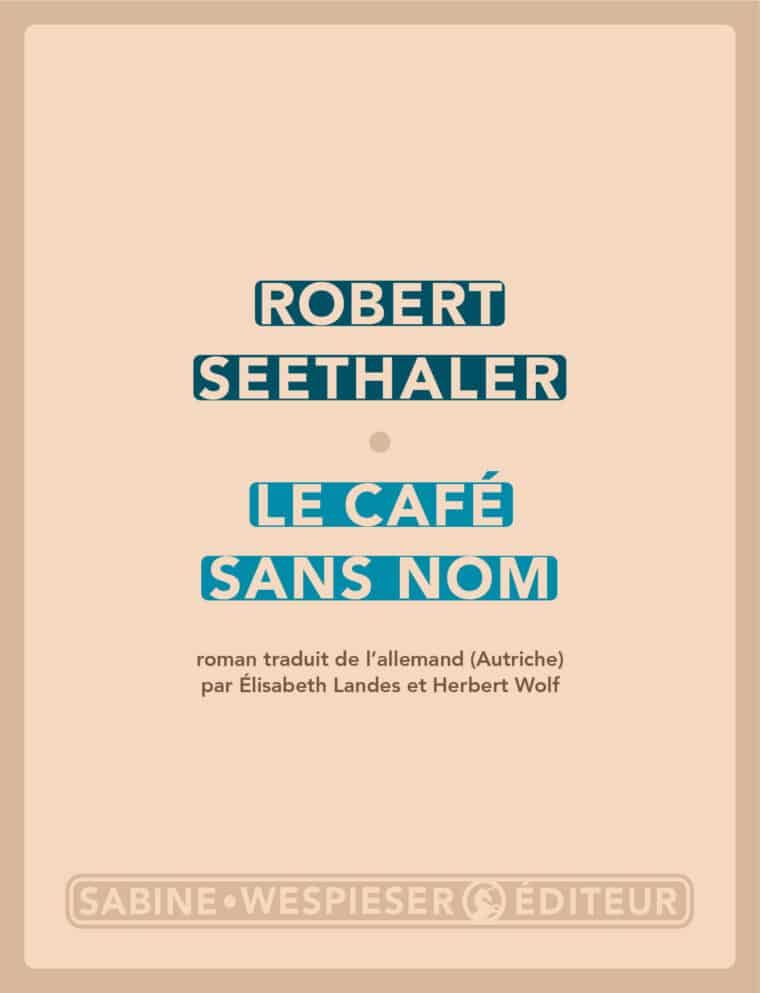
- Livre : Le Café sans nom
- Auteur : Robert SEETHALER
- Article complet
- Revue de presse
LE MATRICULE DES ANGES, Feya Dervitsiotis, septembre 2023
Un dernier verre.
À travers le récit poignant de la vie et la mort d’un café populaire dans la Vienne des années 1970, Robert Seethaler ressuscite un interstice temporel et social.
Les livres de Robert Seethaler tournent le dos au contemporain. D’un pur réalisme, ils semblent d’un autre temps. Le Tabac Tresniek (2014), Une vie entière (2015), qui le rendent célèbre dans l’espace germanophone, déroulent avec naturel des vies dans l’Autriche du XXe siècle. L’écriture se coule dans le moule de l’existence pour dessiner, avec douceur et mélancolie, les dimensions d’un homme. Les deux textes suivants expérimentent différemment, décalquant comme de biais ce sujet qu’est l’existence : dans Le Champ (2020) les morts d’un cimetière se racontent tour à tour, tandis que Le Dernier Mouvement (2022) s’empare des derniers mois de Gustav Mahler. Le Café sans nom, paru cette année en allemand, a cette fois pour centre un lieu de sociabilité autour duquel gravitent les personnages et la narration.
Linéaire, le roman raconte l’histoire d’un café dans un quartier populaire de Vienne entre 1966 et 1976 – soit l’envers des représentations du café viennois sophistiqué et culturel. Au début, les rues sont encore recouvertes de la poussière des décombres de la guerre ; à la fin, les premiers supermarchés ouvrent. Entre les deux, nous lisons les derniers moments d’un monde depuis le point de vue du café et surtout de son incarnation, le gérant et fondateur Robert Simon.
Ceux qui viennent d’asseoir là pour un soda-framboise ou un schnaps sont des ouvriers et petits artisans, des filles d’usines comme des veuves de guerre, un boucher et une crémière du marché juste devant – des figures locales qui forment ensemble une composition harmonieuse, chacun se contenant de n’être « qu’un petit rouage d’un immense organisme, bruyant, palpitant ». Un fois présentés les visiteurs réguliers, le livre forme une ronde où l’on passe d’une histoire à l’autre : le lecteur a pris place, il écoute les conversations des autres tables. Une série d’expériences humaines fondamentales se nouent entre les occupants du café et sont permises par ce contrepoint social essentiel à la vie privée et professionnelle. De temps à autre, une faible rumeur rapporte les mutations que connaît Vienne – la construction du métro, la fermeture d’usines – et qui préfigurent la fermeture du café, sans que jamais la politique de la période, sur laquelle aucun d’eux n’a prise, soit discutée. « Un bus plein de femmes triste se mit en route au soleil couchant. » Alors, ils boivent un coup.
Robert Seethaler se place à l’opposé d’un Pierre Michon, et à la hauteur de personnages minuscules. Toujours relativement brefs, ses textes ne cherchent pas à rehausser son sujet par une écriture magnifiée. Seul l’essentiel y figure, sans gras, sans fioritures, sans folklore non plus, comme en accord avec ceux dont il s’agit : des gens simples et dignes, soudés entre eux. En l’absence d’artifices visibles, leur grandeur apparaît d’elle-même et s’impose par-delà la sobriété de l’expression. La nostalgie de Robert Seethaler (ses livres s’arrêtent systématiquement avant les années 1980) se laisse oublier tant la densité picturale de son écriture, sa limpidité et sa précision, semblent aboutir à une paradoxale résurrection. Le courant bouleversant de la narration, au rythme évocateur de l’inéluctabilité du temps, témoigne de la plénitude et de la solidité d’un univers social qu’il liquide dans un même mouvement.
Parmi les subtilités de ce roman, le travail d’écrivain de Robert Seethaler se confond avec celui de son personnage principal, lui aussi nommé Robert, qui ouvre son café l’année de naissance de l’auteur viennois. L’un et l’autre deviennent écrivain et gérant de café en œuvrant selon un temps humain, à contre-courant de la frénésie moderne. Tous deux parviennent à rassembler, dans un seul lieu et pour un temps, des êtres humains. Pour les clients, comme pour les lecteurs, c’est extraordinaire.