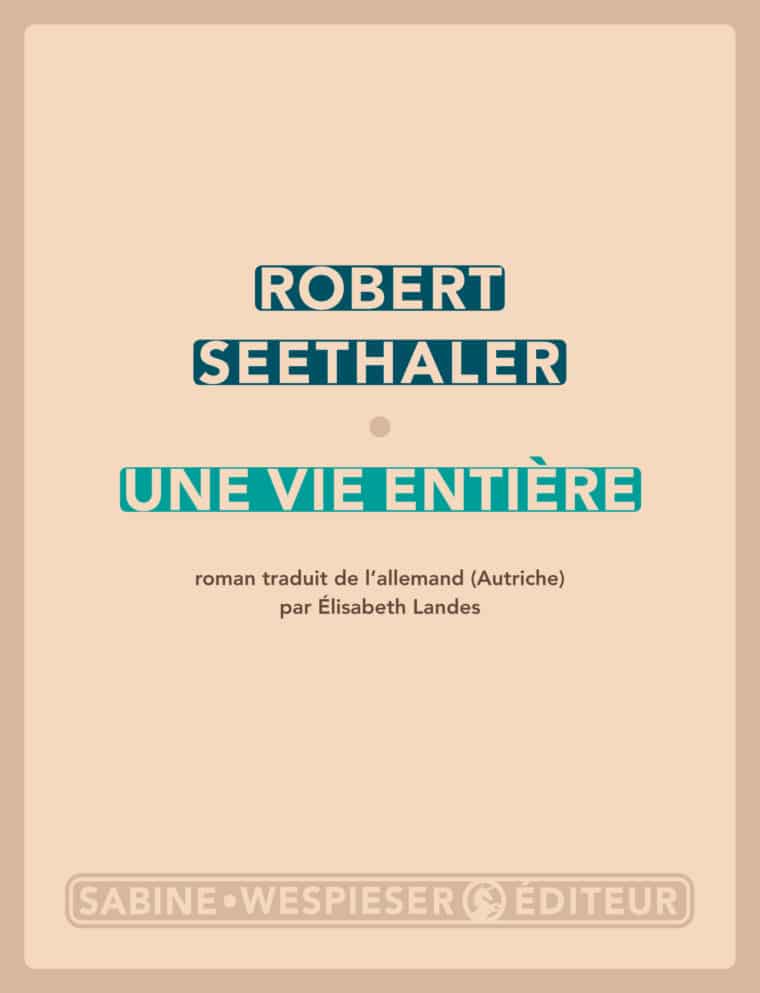
- Livre : Une vie entière
- Auteur : Robert SEETHALER
- Article complet
- Revue de presse
LE MONDE DES LIVRES, Pierre Deshusses, vendredi 9 octobre 2015
« Un destin simple dans l’air limpide »
« L’Autrichien Robert Seethaler traverse le XXe siècle pour raconter Andreas, qui ne quitta les Alpes que pour faire la guerre. Une épure.
Autant le dire tout de suite : ce livre est un petit bijou. En moins de 160 pages, Robert Seethaler redonne à la lecture ses plaisirs simples et ses grâces. Une vie entière commence par une scène insolite. Nous sommes en 1933, quelque part dans les Alpes autrichiennes. Andreas Egger ramène dans sa hotte le chevrier du village qu’il a trouvé presque inanimé dans sa cabane. La descente est difficile dans la neige profonde, mais Andreas n’a qu’une seule peur : que le chevrier vienne à mourir littéralement dans son dos. Il lui parle sans savoir s’il l’entend, l’adjurant de rester en vie, lorsque soudain il trébuche et tombe. Profitant de cet incident, le chevrier, qu’Andreas croyait à deux doigts du trépas, se dégage d’un coup de la hotte renversée et, après un bref instant d’hésitation, part en courant dans la montagne où il disparaît. Ils se reverront – presque un demi-siècle plus tard.
Andreas Egger est un bâtard, confié très tôt à un couple de paysans peu après la mort de sa mère aux mœurs légères. Ne sachant pas exactement la date de sa naissance, le maire du village décide de la situer le 15 août 1898. Dès qu’il est en âge de travailler, il est exploité, battu à la moindre incartade : un plat renversé, un bafouillement pendant la prière du soir… Pendant toutes ces années passées à la ferme, il demeura l’étranger, celui qu’on tolérait, le bâtard d’une belle-sœur châtiée par Dieu, qui devait la clémence du fermier au seul contenu d’un portefeuille de cuir pendu à son cou. En réalité, on ne le considérait pas comme un enfant. Un jour, un coup à peine plus fort que les autres lui casse le fémur. La blessure est mal soignée par un rebouteux. Andreas boitera toute sa vie. C’est cette vie que Robert Seethaler (né en 1966 à Vienne) retrace sous forme de chronique avec parfois des anticipations et des retours en arrière, mais sans jamais perdre de vue l’axe narratif qu’il a choisi et qui se reflète dans l’ambitieuse limpidité du titre. Une histoire épurée et merveilleusement racontée, dont l’atmosphère rappelle celle des récits d’Hermann Lenz (1913-1998), qui souvent met en scène des gens simples dont la simplicité même crée un rapport d’attachement et une impression de clarification du monde.
La vie d’Andreas se confond avec celle du village où il grandit, après s’être enfui de chez le paysan qui le battait. Ne sachant où aller, il travaille comme journalier, loue un coin de terre dans la montagne avant de se faire engager par la compagnie qui construit le premier téléphérique de la région et qui, du même coup, amène l’électricité jusqu’au fond de la vallée. Travailleur, taiseux, habile en dépit de sa boiterie, Andreas découvre même l’amour et épouse la serveuse du village. Les semaines et les mois qui suivirent l’inauguration de la station supérieure furent la période la plus heureuse de sa vie. Mais la montagne n’a pas dit son dernier mot : une avalanche détruit sa maison, emportant la femme qu’il aime. De nouveau seul, accablé de tristesse, il décide de s’enrôler dans la Wehrmacht – qui refuse cet éclopé. Elle fait moins la fine bouche, trois ans plus tard, et le rappelle en 1942 pour l’envoyer sur le front de l’Est. Seul voyage de sa vie. Fait prisonnier après la victoire de l’Armée rouge, il ne revient qu’en 1951. Seethaler ne consacre que douze pages aux années de guerre, mais quelle intensité ! Si la concision est l’un des points forts de l’écrivain, la justesse mâtinée d’une douce ironie en est un autre. Et s’il se paie parfois le luxe de clore un paragraphe de façon brusque, c’est une brusquerie qui, reliant soudain deux éléments éloignés ou oubliés, ouvre comme un tour de clé, un nouvel horizon.
Seethaler accompagne son personnage jusqu’à la fin. D’après son extrait de naissance qui, selon lui, ne valait même pas l’encre de son tampon, Egger atteignit l’âge de 79 ans. Il avait tenu plus longtemps qu’il l’eût jamais cru possible et, somme toute, s’estimait satisfait. Il avait survécu à son enfance, à une avalanche et à la guerre. La mort arrive doucement. Il semblait d’ailleurs l’attendre, la désirer, comme la désirait le chevrier qu’il avait voulu sauver au début du livre et dont le corps raidi par le froid sera un jour retrouvé au fond d’une crevasse par des touristes dont l’affluence a transformé le village d’autrefois en une pimpante station de ski. Il ne s’était jamais trouvé dans l’embarras de croire en Dieu, et la mort ne lui faisait pas peur, écrit Seethaler. Loin de tout flamboiement, la concision d’Une vie entière a la force du vrai. »