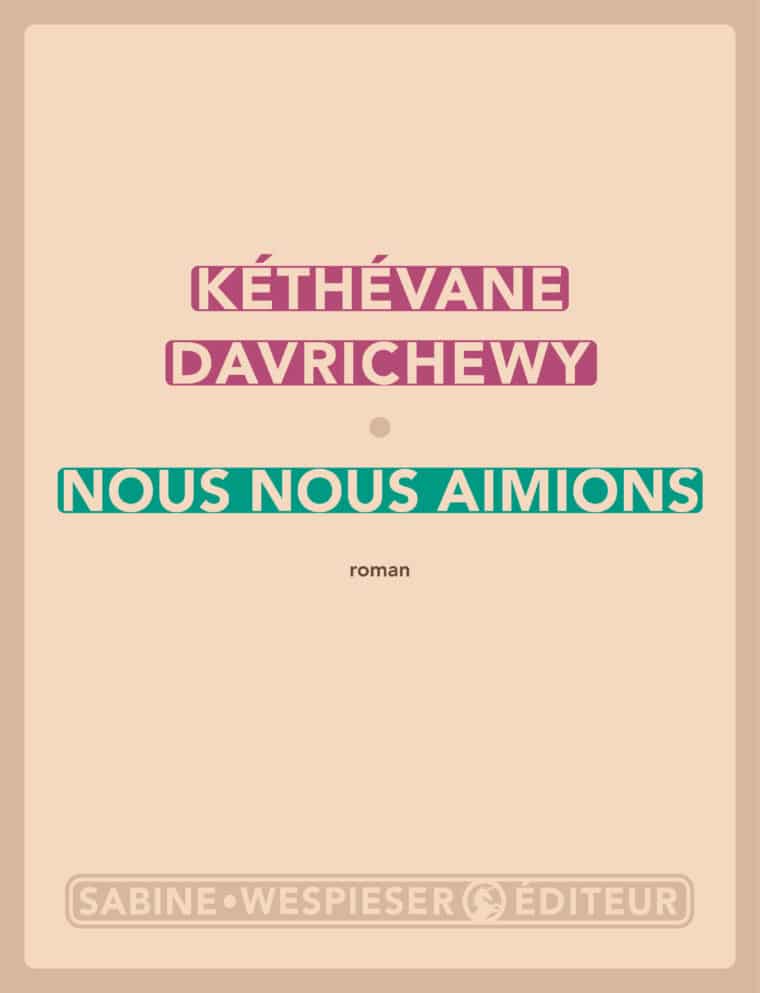
- Livre : Nous nous aimions
- Auteur : Kéthévane DAVRICHEWY
- Revue de presse
LE TEMPS, Isaure Hiace, samedi 19 novembre 2022
Mon pays continuera de rayonner en moi
L’écrivaine française d’origine géorgienne Kéthévane Davrichewy fait le récit d’un délitement, celui d’une famille, et d’une terre, la sienne. Un roman délicat, en forme d’hymne à l’amour.
Aéroport de Moscou, « gris, sale, terrifiant ». Les douanières, aux collants soviétiques affreux, les repèrent de loin : « Voilà les Géorgiennes. » Kessané et sa sœur Tina sont séparées de leur mère, Daredjane, pour être fouillées et minutieusement humiliées. Kessané se retient de pleurer : ne pas leur faire ce plaisir, « bientôt, on sera dans l’avion pour Paris ». Le récit débute dans cet espace de transit, entre la Géorgie et la France. Les trois femmes se rendent chaque été dans la première, les filles découvrent ainsi le pays de leurs parents. Kessané aime la maison d’Abkhazie, où elle respire « l’air de Caucase », savoure la cuisine de Bébia, les chants de Babou – les grands-parents – et les baisers d’Othar, le beau voisin au sourire énigmatique. En France, Daredjane et ses filles retrouvent le père, Tamaz, tendre et drôle, et leur vie familiale paisible.
Le serment des sœurs
1993 sera le dernier été, violent. Les combats font rage entre l’armée russe, alliée aux séparatistes abkhazes, et l’armée géorgienne. La famille ne reverra plus l’Abkhazie. Ce « paradis perdu », dont personne n’ose plus parler, n’existe désormais que dans leur mémoire. « Nous n’habitons pas les lieux, ce sont eux qui nous habitent », confie Bébia, un matin, à sa petite-fille Kessané. À ce délitement d’une patrie se mêle le délitement d’une famille. Après la mort du père, les deux sœurs, devenues adultes, s’éloignent. Enfants, elles se blottissaient l’une contre l’autre dans le grand lit en bois pour « se protéger du monde extérieur », se juraient de ne jamais se séparer. Pourquoi n’ont-elles pas tenu cette promesse ?
Les blessures, les incompréhensions se sont accumulées. Prises séparément, elles pourraient paraître insignifiantes, alors qu’en réalité elles sont autant d’entailles qui finissent par laisser une plaie profonde. Loin d’apaiser les tensions, la mère les attise, malgré elle, trop occupée par sa propre tristesse et sa solitude. Le récit alterne entre les points de vue de Kessané et de Daredjane, le passé et le présent, pour mieux interroger l’intimité d’une famille et la précarité de ses liens. À l’image de l’Abkhazie, qui ne sera plus jamais le lieu du bonheur insouciant, cette famille, amputée du père, ne sera plus jamais l’espace de l’amour réconfortant. « Le mal de l’Abhkazie poursuivra Kessané, comme il poursuivra sa mère et ça sœur, et elles sont incapable de se consoler mutuellement. »
Kéthévane Davrichewy, qui publie ici son cinquième roman aux Éditions Sabine Wespieser, excelle à dessiner, en peu de mots, l’intériorité de ses personnages. L’écriture est pudique, fragile comme de la porcelaine. Une image revient d’ailleurs dans le récit : celle d’une assiette brisée. Chaque été, Bébia offrait a Kessané une précieuse assiette du XVIIIe siècle, vestige de la famille. La première est détruite par la douanière sadique à l’aéroport de Moscou, mais la dernière, ce sont les trois femmes qui la brisent, lors d’une dispute : « Elles étaient restées toutes les trois, tremblantes de rage, hébétées par leur propre violence devant les débris. » À l’image de ces morceaux d’assiette impossible à recoller, le lien entre ces femmes semble brisé à jamais.
Pour s’aimer plus fort
Nous nous aimions est le récit d’un fil rompu, lorsqu’il est déjà trop tard, et nous pousse ainsi, nous lecteurs, à sonder nos propres relations, nous encourageant, en filigrane, à nous aimer plus fort. Car de l’amour, il y en a dans ce livre, dont Othar, à la fois proche et détaché de la famille de Kessané, est une figure lumineuse. Elle le croyait mort dans les combats, elle le retrouve par hasard et ils s’aiment, plus fort encore que dans leur adolescence. Peut-être est-ce cet amour qui donne à Kessané le courage d’écrire une lettre à sa mère, qui conclut le roman : « Je voudrais tisser avec les mots une couverture qui nous protégerait, à défaut de nous rapprocher […]. T’écrire que je porte en moi la mère merveilleuse que tu as été. Elle demeure. Je me souviens que nous nous aimions. »