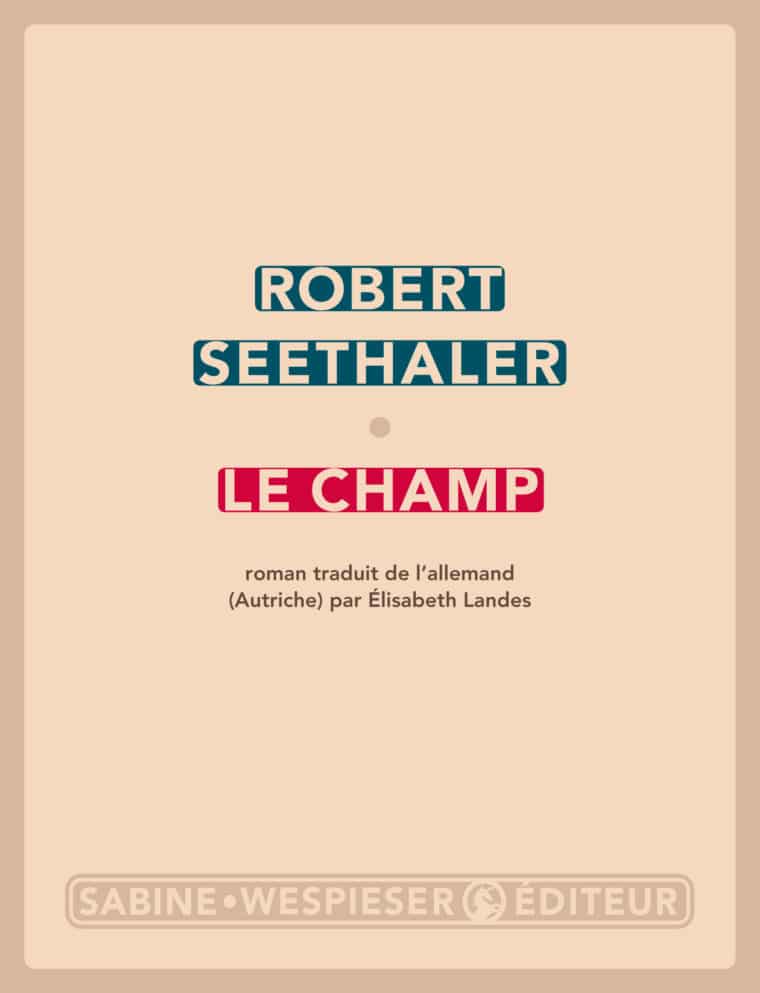
- Livre : Le Champ
- Auteur : Robert SEETHALER
- Article complet
- Revue de presse
LE MONDE DES LIVRES, Pierre Deshusses, vendredi 17 janvier 2020
« Avec Le Champ, l’écrivain autrichien Robert Seethaler signe un splendide roman polyphonique qui parle de l’existence – depuis le cimetière.
Si les morts se mettaient à parler, de quoi discuteraient-ils ? De la vie, évidemment. Cette réponse en forme de pari, l’écrivain autrichien Robert Seethaler en fait le cœur de son nouveau roman, Le Champ – titre aussi bref qu’il nous emporte loin. « Le Champ » est en effet le nom employé par les gens de la petite ville (fictive) de Paulstadt pour désigner l’ancien cimetière : un endroit calme, presque à l’abandon, mais où, à l’écart de l’animation citadine, bruissent des voix parfaitement audibles pour qui sait les entendre. C’est le cas de « l’homme » que l’on découvre dans le premier chapitre, un être sans nom, universel, qui aime venir s’asseoir « sur un banc sous un bouleau tordu » et qui, dans le silence de son imagination, donne voix aux défunts.
Si l’on s’attend à un livre triste, on en est pour ses frais. En vingt-neuf chapitres d’inégale longueur – de deux simples mots (mais quels mots !) à une vingtaine de pages –, chacun consacré à une personne ayant vécu à Paulstadt depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Seethaler fait revivre des existences, dévoile leurs faces cachées, exprime des espoirs, des regrets, des joies. Si bien qu’on a parfois l’impression de regarder tous ces destins par le trou d’une serrure : celle de la porte d’un paradis sans Dieu. […]
De portrait en portrait, de voix en voix, le doute court comme un fil rouge à travers les pages. Le doute, le grand doute, celui qui concerne un possible au-delà, car le roman, même s’il ne livre que des fragments d’autobiographies, parfois même seulement le détail d’une vie, est toujours solidement ancré dans le réel. Journaliste, femme du monde, institutrice, prostituée occasionnelle, mécanicien… aucun des personnages ne croit à la transcendance. Pas plus l’homme du début, que l’on finit par retrouver dans le dernier portrait, où l’auteur lui donne enfin un nom. C’est d’ailleurs lui qui conclut : « Réfléchir à la mort de son vivant. Une fois mort, parler de la vie. À quoi bon ? Les vivants n’entendent rien à la première ni les morts à la seconde. Il y a des pressentiments. Il y a des souvenirs. Les uns et les autres peuvent tromper. »
Ce qui ne trompe pas, en revanche, c’est le talent de Robert Seethaler. Après Le Tabac Tresniek et Une vie entière (Sabine Wespieser, 2014 et 2015), ce troisième roman est à nouveau une réussite. Seethaler a non seulement le savoir-faire mais, dirait-on, « l’instinct » pour évoquer, sans bavardage ni lourdeur, un paysage, une ambiance, une humeur, une attitude, dans un style très bien servi par la traduction. Certes, il ne nous donne pas à entendre vingt-neuf voix différentes. Mais même le meilleur des auteurs ne saurait créer vingt-neuf styles d’expression distincts. Ce qui ici fait la distinction entre les personnages est de nature plus profonde : c’est la liberté que chacun découvre dans sa propre parole, sa façon d’exprimer l’intime. Que ce soit l’épouse qui émet des reproches d’outre-tombe à son mari, l’homme qui décrit la femme idéale ou le curé qui clame sa folie, on est chaque fois confronté à une parole de liberté et de vérité. Chacun « parle vrai » parce qu’il est libéré du corps, du poids physique de l’existence, parce qu’il n’est plus que pensées et émotions, et surtout parce qu’il s’est délesté de la peur qui réfrène ou contraint au conformisme, aux convenances, aux feintes rébellions.
À tel point que, en suivant Robert Seethaler, on en viendrait presque à se demander si la littérature authentique ne serait pas la parole des morts, qui met au jour ce que chacun s’efforce d’étouffer de son vivant. »