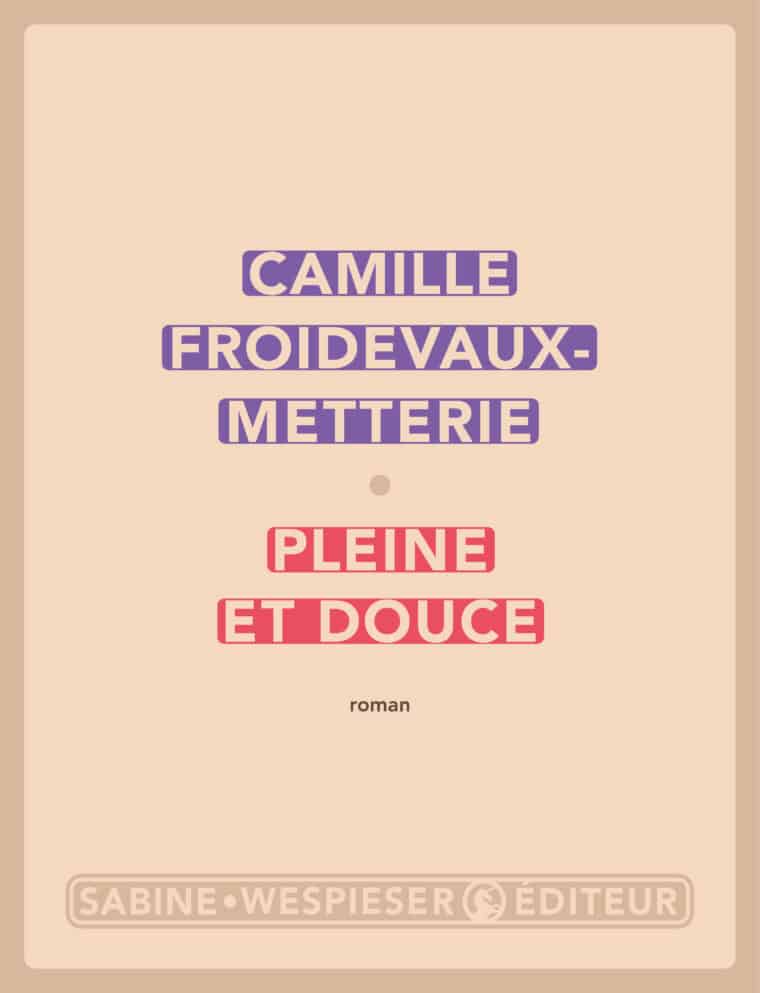
- Livre : Pleine et douce
- Auteur : Camille FROIDEVAUX-METTERIE
- Article complet
- Revue de presse
MARIE CLAIRE, Thomas Jean, mars 2023
Ça démarre par le monologue aussi jouissif qu’interloquant d’un bébé, Ève, qui raconte les attentions dont on la couvre. Autour d’elle, un chœur transgénérationnel de femmes va s’époumoner, murmurer, maugréer… Avec son premier roman Pleine et douce, la philosophe brode une partition subtile et sur tous les tons de la condition féminine, comme elle nous l’explique.
Ce premier roman est-il la continuation fictionnelle de votre travail de philosophe féministe ?
Exactement. Dans la première version de mon essai Un corps à soi (Éd. du Seuil, 23 €), j’avais ouvert chaque chapitre par un récit fictionnel introduisant une thématique corporelle que j’explorais ensuite de manière théorique, mais chez les éditeurs, cette forme-là coinçait. Alors j’ai repris ces textes et me suis retrouvée avec une constellation féminine au sein de laquelle j’ai créé des liens de famille, d’amour, de détestation, en laissant le plus possible derrière moi mes réflexes d’écriture habituels qui sont ceux de l’analyse et de la démonstration. Quand je me suis enfin autorisée à aller loin dans l’imagination et l’intime, j’en ai éprouvé, physiquement, une jubilation.
On sent votre jubilation, aussi, à vous emparer des registres de langage de vos personnages, celui de l’ado, de la retraitée, de la militante…
Écrire comme une ado, d’ailleurs, pourrait vite sonner artificiel, alors heureusement que j’avais une petite conseillère littéraire à domicile, ma fille de 16 ans, pour en tester la justesse. Oui, je me suis beaucoup amusée à chercher ces voix. À chacune d’elles, d’abord, j’ai associé une couleur et un état physique. Gris-rosé et colère, par exemple, pour Laurence la quinqua abandonnée, d’où cette écriture saccadée, obsessionnelle, répétitive. La voix la plus proche de la mienne, c’est finalement celle d’Ève, le bébé qui, par définition, n’a pas de langage.
Stéphanie, mère d’Ève, entretient un rapport respectueux voire amical avec Jamila, sa nounou, tout en montrant bien quand même que la patronne, c’est elle. Vous nous dites par là que malgré toutes les sororités possibles, les hiérarchies sociales sont plus fortes ?
Beaucoup de femmes réussissent leur vie professionnelle grâce à d’autres femmes, non-blanches notamment, qui, elles, ont des vies de dévouement, qui sacrifient leur propre famille pour s’occuper d’une autre. J’ai été frappée, d’ailleurs, pendant les confinements, qu’on parle si peu de ce qu’allaient devenir ces nounous et femmes de ménage souvent payées au black… Cette secondarisation de toute une population féminine, hélas, résiste aux bonnes volontés.
Dans ce roman, les hommes sont en périphérie, même biologiquement, puisqu’Ève naît d’une PMA. Que vous permet d’exprimer cette non-mixité ?
C’est un livre où l’on parle pas mal des hommes mais seulement par la voix, par le point de vue des femmes. L’effet produit, j’espère, c’est un chant féminin où résonne une pluralité de tessitures et de tonalités.
Un chant qui n’est pas sans dissonances, car vous y décortiquez aussi les rivalités entre femmes…
Les femmes qui ont grandi dans une société patriarcale ont dû faire avec, s’en arranger et donc accepter la mécanique de compétition intra-féminine qu’implique le patriarcat. C’est un poison que j’ai moi-même éprouvé à maintes reprises dans le monde académique, où la malveillance des plus âgées à l’endroit des plus jeunes est commune. C’est aussi un argument utilisé par ceux qui pointent les dissensus entre les féministes, qui entre elles seraient soi-disant des sorcières qui se crêpent le chignon. Alors on a tout à gagner à repenser, certes, les relations femmes-hommes, mais aussi à nous soustraire, entre femmes, à ce vieux schéma délétère.